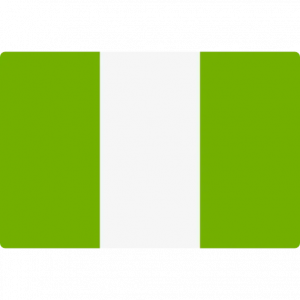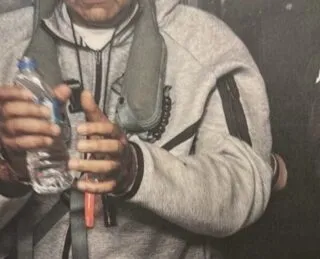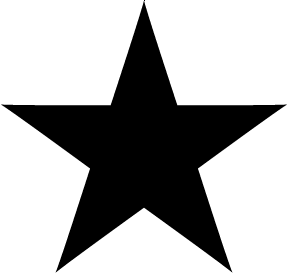- International
Les innovations technologiques peuvent-elles éviter les blessures ?
Ces dernières années, de nombreuses technologies sont mises en place dans le foot professionnel pour limiter les blessures et réduire leur temps de guérison. Comment agissent-elles ? Sont-elles efficaces ? On démêle le vrai du faux avec des spécialistes.

La statistique qui va suivre n’a rien d’étonnant. Entre les saisons 2020-2021 et 2023-2024, le nombre moyen de blessures en Premier League a doublé, passant de 75 à 146 pour l’ensemble des clubs de l’élite anglaise, selon le courtier en assurances britannique Howden. La faute à des calendriers toujours plus étalés sur les années civiles et la création de nouvelles compétitions (et non à une supposée augmentation de rencontres, comme relevé par le CIES l’année dernière) qui durant la dernière décennie a mis en exergue les dernières technologies de pointe pour prévenir les blessures, voire réduire leur durée. Pour comprendre l’hécatombe générale, comme celle que l’on peut voir actuellement en équipe de France, il faut se plonger avant même la blessure. Là où toutes sortes de gadgets se sont démocratisés dans les clubs pros.
Tout le monde disait : “La cryo c’est génial, ça résout tous les problèmes”… pour finalement en revenir au bon vieux bain écossais avec des contrastes chaud-froid !
À commencer par le GPS, symbolisé par ces brassières portées par les joueurs en entraînement et en match. Elles sont le point de départ d’une récolte copieuse de données, comme l’explique Emmanuel Vallance, directeur de la performance au Toulouse FC : « Beaucoup pensent que ça ne sert qu’à mesurer des déplacements. Ce n’est pas vrai, il a plusieurs fonctions. Il intègre aussi un gyroscope, qui permet de situer l’athlète dans l’espace et un accéléromètre pour recueillir des données liées aux accélérations. L’important, c’est de ne pas se baser sur les données de l’équipe, mais par rapport à l’individu. »
Une montagne de datas qui permet aux staffs de cuisiner des menus à la carte. « À J+1, on peut ensuite adapter un entraînement à un joueur parce qu’on a vu que l’un des indicateurs était dans le rouge. C’est vraiment propre à l’athlète », poursuit-il. Le Real Madrid utilise notamment la thermographie infrarouge, qui détecte la surcharge et la fatigue des muscles chez le joueur. En 2022, une étude effectuée au CD Nacional (D1 portugaise) a d’ailleurs montré que son usage contribue à réduire d’environ 70% les blessures musculaires d’une saison à l’autre. Que les tech-addicts ne s’emballent pas trop, déceler un risque de blessure est aussi réalisable avec des techniques bien plus évidentes.
Algorithmes, effets de mode et ressenti
Celle adoptée par Baptiste Lacourt, préparateur physique indépendant de joueurs de Ligue 1, se compose de tests de sauts et de force analysés par de simples capteurs. « Mon athlète est allongé sur le dos, j’arrive à lui lever la jambe à 90°. Je lui demande ensuite de le faire tout seul, mais il ne la lève pas à plus de 20°. Donc il y a risque de blessure, parce que manque de contrôle musculaire. » Un calcul mathématique tout bête qui cohabite aujourd’hui avec l’IA, les algorithmes et les prédictions.
À Toulouse, le staff mise sur l’apprentissage automatique (machine learning en anglais), un système qui à partir des données permet de faire des prédictions dans le temps et d’anticiper un risque de pépin. « Sur une semaine d’entraînement, on peut maintenant déceler d’éventuelles problématiques si on change un paramètre. C’est encore très abstrait, mais ça commence à se démocratiser », poursuit Emmanuel Vallance, dont la thèse parue en 2023 porte justement autour de la fiabilité de l’apprentissage automatique, dont les modèles ont réussi à prédire les niveaux d’effort de 38 joueurs pros avec 60% moins d’erreurs que des prédictions aléatoires.

À l’affût quand il s’agit de limiter la casse dans les effectifs, les staffs n’échappent pas au marketing voulu par le business des nouvelles technologies. À la barre des tendances en vogue, la cryothérapie. Une méthode qui utilise le froid pour soulager la douleur et améliorer la récupération après un effort physique intense, louée par les plus grands clubs dès les années 2010. « La cryo agit positivement sur la sensation de bien-être et d’endormissement, donc pour les siestes, c’est top. En revanche, elle n’a jamais montré que ça réduisait des inflammations. Il y a quelques années tout le monde disait : “C’est génial, ça résout tous les problèmes”, avec énormément d’études et de moyens mis là-dessus… pour finalement en revenir au bon vieux bain écossais avec des contrastes chaud-froid ! », simplifie notre thésard, passé par les staffs de Nice et d’OL Lyonnes. Un retour à l’essentiel, parfois nécessaire tant dans le matériel que dans l’humain. « Pour moi, le plus important reste la communication et le ressenti de mon athlète via le questionnaire pré et post-entraînement », tranche Emmanuel Vallance. Crayon à papier 1, superordinateur 1.
Formation et course contre la montre
La technologie n’est quand même pas de refus pour cibler une période charnière du footballeur professionnel : sa formation. L’adolescence, dans toute son ingratitude, accouche de grandes différences morphologiques entre les jeunes joueurs, souvent logés à la même enseigne dans le travail physique sur lequel on met particulièrement l’accent dans les centres de formation français. Un besoin de rééquilibrage mesuré par le bio-banding, une technique importée d’Angleterre qui consiste à regrouper les joueurs en fonction de leur âge biologique, et non par rapport à leur âge réel.
« Quelqu’un qui a 12 ans peut en avoir 14 dans son développement physique, ou l’inverse. L’avantage de détecter ça, c’est de pouvoir ensuite quantifier la charge d’entraînement de chacun », déroule Loïc Fournet, ostéopathe. Une formation mal dosée amène un risque de blessures à répétition plus élevé une fois la croissance terminée. En écho aux cas d’école Dani Olmo et Pedri (blessés à répétition à un âge peu avancé), le FC Barcelone a décidé de miser sur le test ADN. Le club catalan collabore depuis de nombreuses années avec sa start-up locale SM Genomics pour déceler les faiblesses musculaires, tendineuses et ligamentaires via la génétique. Gavi en salle d’attente ?
🧬 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀 𝐌𝐃: Conclusiones positivas tras el estudio genético a Dani Olmo ✅ Sus parámetros se encuentran dentro de la normalidad 💪 Ahora, el cuerpo técnico podrá ajustar su preparación para maximizar su potencial ✍️ @martinezferran https://t.co/caOJVncvoq
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 21, 2025
Agile quand il s’agit de prévenir une blessure, la technologie est-elle capable d’agir une fois que le mal est fait ? Elle propose en tout cas de nombreuses pistes dont l’usage ne fait pas encore l’unanimité. Avec en tête le caisson hyperbare, une installation étanche dans laquelle le sportif est exposé à une pression supérieure à celle de l’atmosphère. « Il réduit considérablement les temps de cicatrisation sur les blessures type ischio-jambiers. On peut facilement gagner un tiers du temps de blessure », affirme Baptiste Lacourt à propos d’une technologie très utilisée au PSG et sortie de l’anonymat l’an dernier lors de la tentative d’un retour express de Kevin Mayer, finalement contraint de renoncer aux JO de Paris à cause d’une lésion… à l’ischio, justement. « Il y a quand même un décalage entre la théorie et la pratique, et les résultats sont multiples », situe Loïc Fournet, membre du staff du décathlonien lors d’une course à la guérison qui relevait du « miracle de ouf ».
Le caisson hyperbare réduit considérablement les temps de cicatrisation sur les blessures type ischio-jambiers. On peut gagner facilement un tiers du temps de blessure.
Réduire un temps de blessure est également possible par injections. La plus répandue est celle à partir du plasma (PRP), un procédé qui consiste à réinjecter la partie du sang du patient la plus riche en plaquettes dans la zone blessée pour stimuler la cicatrisation. D’autres usent de techniques peu orthodoxes, comme le Dr. Müller, médecin historique du Bayern Munich et roi de la piquouze au sang de veau (coucou Franck Ribéry et Arjen Robben). Médecin de l’équipe de rugby du Stade français Paris, le Dr Eliott Rubio appelle à la raison : « Je n’utilise rien de tout ça. Il y a un vrai risque d’infection. Pour le plasma de veau, on rentre même dans le dopage. Il y a 10-15 ans, on essayait ces injections dans plein de situations différentes, maintenant le nombre d’indications se précise au fur et à mesure. »
Ce médecin du sport en parallèle de ses engagements avec le club du 16e arrondissement est davantage adepte de l’électrostimulation (qui ne sert pas qu’à la gonflette de CR7), dont l’objectif est de contracter par décharges électriques un muscle au tout début de la guérison. « Par exemple sur une cuisse, ça permet à la hanche et au genou de ne pas bouger pendant une contraction du quadriceps. Ça permet un bon alignement des fibres et c’est très intéressant pour gagner du temps avant le retour au jeu », détaille-t-il. Une folle course au temps, qui n’a pas encore vu de recette miracle faisant consensus. Le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir » n’a jamais sonné aussi vrai.
Sans Mbappé, le Real assure face au BetisPar Théo Juvenet
Tous propos recueillis par TJ