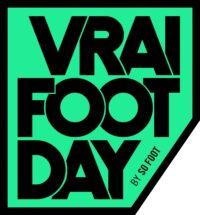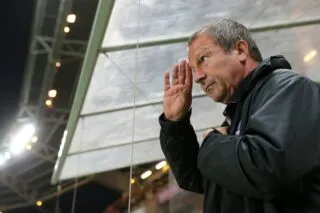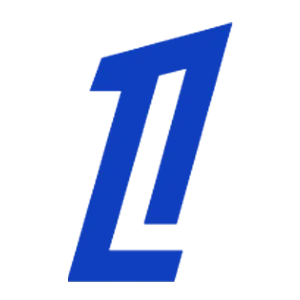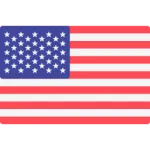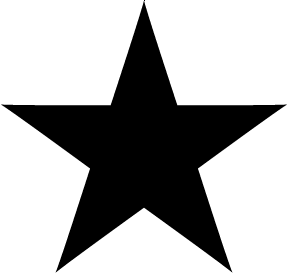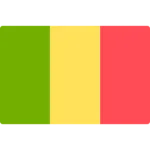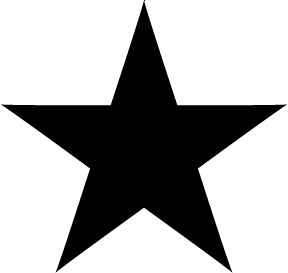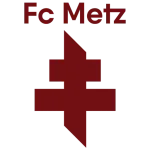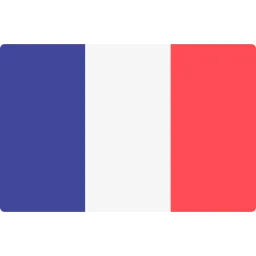- Sortie du So Foot n°182
Voilà pourquoi il n’y a pas de Rashford français

Marcus Rashford est devenu un exemple. Une sorte d'idéal du footballeur engagé qui n’oublie pas ses origines sociales et devient d’un coup, non seulement un modèle, mais tout simplement un acteur politique. Toutefois, alors que la France du foot, et même de gauche, se tourne amourachée vers Manchester et la perfide Albion, se désolant du manque d’équivalent chez nous, une question se pose : est-ce que nous avons bien saisi la particularité du personnage, et de son action ? Une originalité qui de fait explique grandement pourquoi une telle « anomalie » reste fort peu probable, voire impensable, en France.
Une petite chansonnette triste qui a accompagné tout ce second confinement. Le sport en France ne sera pas assez ou du tout considéré, voire toujours finalement méprisé. Pour preuve, le peu d’aide – surtout pour son versant amateur – qu’il a pu recevoir de l’État, en comparaison notamment avec la culture (ce qui est fort bien par ailleurs pour cette dernière, n’oublions pas le parrainage d’Albert Camus). La rengaine n’est certes pas vraiment nouvelle. À force d’entonner le refrain de l’apolitisme, le monde sportif et même le football ont fini par accepter ce rôle, qui oscille ensuite entre les affres de la récupération ou l’épée de Damoclès de la démagogie. Le ballon rond est évidemment devenu aujourd’hui incontournable « par chez nous » . Économiquement, culturellement, et bien sûr socialement. S’est-il pour autant transformé en un espace « politique » comme il devrait l’être, à la mesure de son importance dans le pays et de son poids dans la jeunesse ? Les propos de quelques Bleus après les bavures policières ont suffisamment étonné pour que cela démontre en creux, en 2020, à quel point il est inhabituel, et probablement indésirable, qu’ils se permettent pareil hors-jeu.
Football makes politic
Trop nombreuses sont surtout en France les belles âmes qui n’ont pas percuté les différentes facettes, finalement la cohérence, de ce qu’avait accompli Marcus Rashford. Il ne s’agit en rien d’une quelconque démarche de philanthropie, ce dont se révèlent tout à fait aptes pour le coup, et régulièrement, nos stars à crampons hexagonales. Le Mancunien a utilisé, presque par devoir, son statut pour interpeller son gouvernement, mobilisé des députés, des élus du peuple, pour que l’État assume sa mission envers les enfants les plus démunis du Royaume, et ce via un service public. Nous sommes à des années-lumière des campagnes pour des pièces jaunes ou les Restos du cœur. Marcus Rashford ne se l’est pas permis malgré le fait qu’il était footballeur, mais justement au nom de cette particularité. Le football est pleinement reconnu au sein du Royaume-Uni comme une part constitutive de l’identité nationale, et longtemps spécifiquement de la classe ouvrière qui, comme l’écrivait l’historien marxiste Eric J. Hobsbawm, reposait sur trois piliers : le club, le pub et le syndicat.
Nous sommes en 2020 dorénavant. Toutefois, en tant que footballeur, Marcus Rashford sait qu’il possède une légitimité et quelque part une obligation de penser plus loin que le terrain de foot, puisque le terrain se trouve bien au centre de la vie de la cité.
République du foot ?
En revanche, sous les ors de la République, les footballeurs, surtout en exercice, sont encore soumis au soupçon de l’imposture. Leur méritocratie ne répond pas aux critères habituels : universitaires, militaires ou patrimoniaux. Pas besoin des centres de formation pour qu’ils comprennent vite, que davantage que toutes les Zahia, leur parole politique peut s’avérer obscène aux yeux et aux oreilles de la plupart de nos élites, surtout dans les ministères ou les travées de l’Assemblée. Imaginons-nous Kylian Mbappé se rendre auprès de François Ruffin pour faire voter une loi en faveur de l’encadrement des enfants autistes dans le milieu scolaire. Certains poufferaient d’indignation, à une sorte de vulgarité et de nivellement par le bas du débat parlementaire. Cela n’aurait rien d’indigne. Cela pèserait plus qu’un tweet et rappellerait que la démocratie signifie le pouvoir au peuple. Et que les joueurs de foot font partie du peuple.
Marcus Rashford – Super Man of the Year : c’est à retrouver dans le numéro 182 de SO FOOT, actuellement en kiosque J’irai dormir chez vous : l’autre magie de la Coupe de Sochaux-Lens
Par Nicolas Kssis-Martov