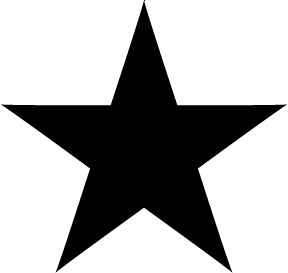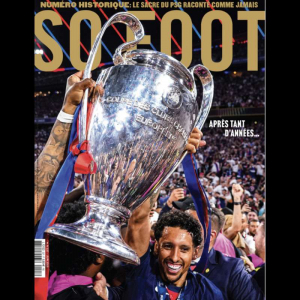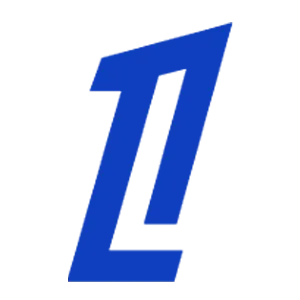- France
Jean-Claude Darmon : « À l’époque, j’étais le diable »

Col roulé du charmeur et survêtement du sportif. À 84 ans, Jean-Claude Darmon ne compte pas s’arrêter de sitôt. Celui qui a longtemps fait la pluie et le beau temps du business du foot français s’attelle désormais à contrôler minutieusement la campagne médiatique de son livre Destin (Fayard) et du documentaire qui lui est consacré par Canal+, L’Argentier. Au cœur de son bureau au-dessus duquel planent les fantômes de Pelé, Claude Bez, Alain Delon, Mohamed Ali ou Johnny Hallyday, l’homme d’affaires continue de lutter contre l’oubli.
En 2016, vous avez publié votre première autobiographie. Pourquoi avoir décidé d’en écrire une autre, près de dix ans plus tard, alors qu’il semble ne rien s’être passé depuis ? Ce n’est pas la même histoire. Le premier livre était celle d’un entrepreneur (Au nom du foot, Fayard). Le deuxième (Destin : avoir plus de rêves que de souvenirs, toujours chez Fayard) raconte le parcours d’un enfant, d’un fils, d’un frère, avec les jalons de ma vie professionnelle, jusqu’au résultat qu’on connaît. Le foot a évidemment une place centrale. Si j’enlève ma famille, il ne me reste que le football.
Vous citez souvent Albert Batteux et José Arribas. On peut dire que vous êtes un romantique ? Je suis un romantique du foot ! Je suis un artiste, mais c’est terrible de dire ça quand on fait une carrière financière. J’aime ce qui est beau. Je regarde énormément d’équipes, tout le monde s’en étonne parce qu’ils pensent que je ne regarde que le PSG ou Marseille, mais j’aime trop le foot pour ne pas tout regarder. La dernière fois, au Parc des Princes, sous -50 degrés, j’ai dit que Le Havre était une super équipe, et un ponte du Paris Saint-Germain dont je tairai le nom m’a dit : « Oh, tu trouves ? N’importe quoi. » Mais il faut regarder le jeu, pas seulement le résultat, parce que Le Havre a un budget de 24 millions contre 800 pour Paris, c’est normal qu’une Ferrari batte une trottinette. Je ne supporte pas d’équipe : j’ai été épris du PSG et de l’OM des années 1990, parce qu’il y avait des joueurs fantastiques à chaque poste, je suis né professionnellement au FC Nantes dans les années 1960 et j’ai été gâté parce que c’était la meilleure équipe qui soit, j’ai été ami avec Claude Bez dont les Girondins avaient une attaque formidable, j’ai été ami avec Jean-Louis Campora qui avait une super équipe à Monaco… Moi, j’adore l’attaque, alors que je suis un défenseur bourrin. J’ai une admiration pour ces artistes, ce sont tous des Picasso.
La vérité, ce que j’aurais aimé être Zidane, Just Fontaine ou Pelé, mais Dieu m’a donné d’autres qualités.
Comment fait-on pour garder son amour du jeu quand on a toujours l’argent en ligne de mire ? Ce qui m’a amené à cette carrière, c’est que je n’ai jamais pensé à l’argent… Navré de vous le dire. J’ai surtout pensé à la reconnaissance. La vérité, ce que j’aurais aimé être Zidane, Just Fontaine ou Pelé, mais Dieu m’a donné d’autres qualités. Pour avoir un rôle prépondérant dans le football national et international, j’ai dû m’inventer et me réinventer. J’ai donc créé quelque chose qui n’existait pas : l’économie du football. J’ai révolutionné mon secteur, un peu comme certains footballeurs.

C’est possible de révolutionner l’économie sans penser à l’argent ? Oui, parce que l’argent est un moyen, pas une fin. Il faut remettre les choses dans leur contexte : avant, le foot, c’était du patronage, ça n’avait rien à voir avec ce qu’on connaît aujourd’hui. Justo (Fontaine), meilleur buteur de la Coupe du monde, 13 buts, il touchait à peine le smic. Quand tu vois les salaires de Messi ou Ronaldo, ça n’a aucun sens. On est passé de mourir de faim à acheter une bagnole toutes les trois minutes. Aujourd’hui, c’est facile de me voir comme ça, mais à l’époque, j’étais celui qui apportait de l’argent dans le sport, j’étais le diable, c’était honteux pour tout le monde. Je n’ai jamais été aimé par le ministère des Sports. Je n’ai pas eu la Légion d’honneur à cause du ministère des Sports.
En tant que spectateur, auriez-vous préféré un foot sans publicité et moins porté sur l’argent ? Ça n’existe pas. C’est une vision française, ça. Ici, l’argent est sale, mais tout le monde en veut, de l’ouvrier au directeur général d’une multinationale. Ce n’était pas logique que des footballeurs, qui créent du spectacle, soient sous-payés, mais ils l’étaient parce qu’il n’y avait pas de recette. Alors à partir du moment où j’ai amené des recettes avec des panneaux publicitaires, des sponsors maillot, des droits télévisés, des loges, il était logique que cet argent profite aux joueurs. Je vous mets au défi de trouver un club qui génère des revenus.
Vous expliquez dans votre livre que la première chose qui vous marque dans le coup franc de Roberto Carlos contre la France, en 1997, est la présence de vos panneaux derrière le but de Fabien Barthez. Finalement, quelle est vraiment la place du jeu dans le business ? À ce moment-là, ma grande peur, c’est que le panneau tombe. Un panneau qui tombe, pour tout le monde, ce n’est rien, mais pour moi, c’est de l’argent en moins pour le club. Quand Roberto Carlos frappe la balle, qu’il prend une course d’élan toute droite… Tout le monde voit le but, mais moi, je vois le panneau mis en lumière. Ça a été un carnage !
<iframe loading="lazy" title="Roberto Carlos Incredible Free Kick (France 1997) (Sky Sports English Commentary) [HD]" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/crKwlbwvr88?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
Vous pensez encore à ces détails ?
Non, justement, j’ai commencé à revivre devant le football quand j’ai arrêté Sportfive (en 2004, NDLR). J’étais malade. J’avais peur de tout, qu’il y ait du brouillard, qu’un journaliste se mette devant un panneau… Aujourd’hui, je kiffe, je n’en ai rien à foutre de ça. Je n’ai plus d’intérêt, sinon sentimental, de savoir qui va gagner ou perdre.
Comment jugez-vous cette évolution avec un point de vue extérieur ? J’adore que les familles Arnault et Pinault soient dans le foot, parce qu’on n’a peu de dirigeants français à la tête des clubs, c’est plutôt des multinationales américaines, voire des États. Mais, honnêtement, je m’en fous. C’est honteux de dire ça, mais c’est vrai. Ce qui me plaît, c’est le 4-2-4, le WM qu’on a chassé il y a 145 ans, le centre en retrait, c’est ça qui me rend heureux. Donc j’aime bien les clubs qui font avec peu de moyens. Par définition, il faut que vous sachiez que je suis humaniste avant tout. Ne vous étonnez pas que la morale, le panache et le courage priment chez moi.
Je n’ai jamais voulu faire fortune en trois mois. Sinon, j’aurais été agent de joueurs, j’étais pile-poil dans la bonne époque.
On peut vraiment être humaniste dans ce milieu ? (Il hésite.) Pas moins qu’ailleurs. Humaniste, ce n’est pas céder à tout, tout le temps. La preuve, ma force, c’était de savoir dire non et d’avoir le courage de dire non. Il ne faut pas être d’accord avec tout le monde, sinon c’est trop facile. Je ne pratique pas la charité, je pratique la solidarité. J’aime le partage. Je suis sceptique quand je vois certains couples parce que, pour moi, l’amour, c’est le partage. L’amitié aussi. Ce n’est pas partager ce qu’on a, c’est comprendre, aider, tenter de faire. Donc oui, dans tous les milieux, c’est possible quand on le veut.
J’ai du mal à comprendre comment ça se caractérise dans le football professionnel aux enjeux financiers si importants.
J’ai gardé des contrats avec des clubs pendant plus de 40 ans. Ça, ça n’existe pas ailleurs ! On peut mentir à quelqu’un une fois, mais pas à tout le monde tout le temps. On peut trahir un club, mais ça se saurait si on pouvait le faire à tous. Je ne suis pas sûr d’être honnête. La seule chose dont je suis sûr, c’est d’être intelligent. Quand je vais sur un marathon, je ne veux pas être premier aux 100 mètres, ça c’est pour le premier con venu, mais après 42 kilomètres et des poussières. Je n’ai jamais voulu faire fortune en trois mois. Sinon, j’aurais été agent de joueurs, j’étais pile-poil dans la bonne époque.
Ça ne vous a jamais tenté ?
Non. Je l’ai fait une fois en vérité, il y a un siècle (sic), pour rendre service au Nîmes Olympique. On m’avait dit : « Jean-Claude, il faut que tu nous aides. » J’étais à Nantes et on avait (Robert) Gadocha, un des meilleurs ailiers du monde, tu demanderas à ton père, et je devais arranger le coup avec un autre Polonais, Jan Domarski. Il jouait à Stal Mielec, ils avaient une équipe exceptionnelle, mais on tombe quand même d’accord facilement à huit jours de la fin du mercato. Quand on signe le contrat, le vice-président de Nîmes ouvre le champagne. Le joueur dit : « Ça vous dérange si j’appelle ma femme pour venir boire, elle est dans la voiture. » Il descend, on attend une heure, deux heures, trois heures… Il s’est barré, il a cru qu’on l’avait entubé. On m’a envoyé en Pologne, avec de l’argent, pour tenter de le récupérer. Me voilà parti. J’ai trouvé une infirmière qui parlait français et qui a accepté de faire l’interprète. On a fait 400 kilomètres de taxi, pour aller à Mielec. À 2 ou 3 heures du matin, je toquais aux portes des HLM pour savoir où il habitait. On tombe sur Henryk Kasperczak, qui nous dit où il habite. On toque, pas de réponse, donc je donne des coups de pied dans la porte. On a baratiné longtemps, il a accepté, mais il y a eu des problèmes de passeport. Il nous avait donné un passeport intérieur et pas international, il nous avait pris pour des cons. Au bout d’un an, il est venu à Nîmes. Voilà mon premier et dernier transfert. (Rires.) Et, moi, j’ai eu une carrière d’agent bénévole. BÉ-NÉ-VOLE !

Vous vous dépeignez comme un humaniste, mais comment avez-vous fait face, pendant si longtemps, à des gens qui ne l’étaient pas forcément ? J’ai fait la guerre.
C’est-à-dire ? Je suis un homme de paix… Je suis un guerrier qui a de l’empathie. Ce ne sont pas que des mots. Je voudrais sauver la terre entière, je sais très bien que je n’y arriverai pas, mais pourquoi je n’essaierais pas ?
Vous…
(Il coupe.) Ça ne m’empêche pas de gagner ma vie, de me battre pour mes commissions, ça n’a rien à voir. Dans le foot, et ailleurs, j’ai toujours été dans le respect de la parole donnée, des contrats, de la poignée de main. Ça, ça n’existe plus depuis 30 ans. Je réfléchis, mais je n’ai jamais été trahi. Sauf par un club, mais je vais taire le nom. (Il sourit.) Finalement, il a déposé le bilan 20 ans plus tard et je l’ai sauvé.
On pardonne, mais on n’oublie pas ?
L’égo compte quand même. Il y a un proverbe sénégalais qui dit : « Assieds-toi au bord du fleuve et tu verras passer le corps de ton ennemi. » Il n’y a rien de plus jouissif que de savoir que tu as eu raison. J’ai eu tort d’avoir trop souvent raison.
Quelle a été votre principale guerre ?
J’en ai mené quelques-unes. Mais j’ai oublié. Tu sais, à mon âge, on perd la mémoire. (Rires.)
Quand je regardais la Coupe du monde 1958 à la télé, assis sur un trottoir, jamais je n’aurais pu imaginer que je ferais tant de choses dans le foot. J’étais à des milliards d’années-lumière d’y croire
Il y a deux figures du foot français des années 1980 et 1990 qui brillent par leur absence dans votre livre : Bernard Tapie et Michel Platini. Pourquoi ? Franchement, je ne partageais pas grand-chose avec Tapie. On n’avait pas la même vision du football.
Comment est-ce possible pour deux hommes d’affaires comme vous ?
Parce que l’argent, ce n’est pas mon moteur. Tu ne m’achètes pas avec de l’argent. Tu m’achètes avec un coup de cœur, avec un enfant malade, là, tu me baises parce que je suis désarmé. On n’a pas le même parcours. On avait des caractères assez forts. Ça ne me viendrait pas à l’esprit d’écrire un livre en lui consacrant une partie.
Et Platini ?
C’est pareil, on ne peut pas s’entendre avec tout le monde.
Jean-Michel Aulas, Just Fontaine, Claude Bez… Comment se façonnent les amitiés ? J’ai un bol exceptionnel parce que j’ai deux passions : le football et le cinéma. Je vais te montrer les photos (son bureau en est rempli, NDLR). J’ai pu jouer avec quasiment tous les plus grands joueurs de l’histoire, des tennis-ballon, des six contre six. J’ai été l’ami – pas le copain hein -, l’ami de Pelé, tu peux pas faire mieux, de Justo Fontaine, de Kopa, d’Eusébio… Et à côté, je suis passionné de cinéma, je dois absorber 10-12 films minimum par semaine, et j’ai pu être ami avec Alain Delon, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo. Johnny (Hallyday), aussi.

Qui était l’acteur avec qui vous pouviez parler de foot ? Il y avait deux fracassés : Jean-Paul et Lino. Ils adoraient ça. Les deux jouaient, Jean-Paul était gardien de but et Lino était défenseur. Ce qui me rend heureux, c’est qu’ils m’ont tous traité comme leur égal. Je n’étais pas un star-fucker, je n’étais pas un fan, je ne cirais pas leurs bottes, mais ils avaient de l’affection pour moi. Peut-être que c’est mon itinéraire qui leur plaisait…
C’est quelque chose que l’on retrouve dans tous vos récits, cette enfance dans une famille relativement pauvre…
(Il coupe.) Archi pauvre ! Je ne vais pas me rouler par terre, je ne suis pas le seul. Ma seule fierté, c’est d’avoir fait des choses que personne n’avait imaginées quand j’étais jeune. J’ai plaidé à la Commission européenne (pour faire fusionner Sport+, filiale du groupe Canal, et UFA Sports, entreprise allemande de droits télévisuels sportifs, NDLR) et les avocats internationaux des deux parties ont été déboutés. J’ai gagné tout seul, sans note, sans rien, uniquement avec mon papier d’écolier. J’ai vécu des choses auxquelles personne ne pouvait penser. Quand je regardais la Coupe du monde 1958 à la télé, assis sur un trottoir, je voyais Fontaine et Kopa comme des acteurs, comme John Wayne ou Gary Cooper, pour moi ils n’existaient pas. Donc, jamais je n’aurais pu imaginer que je ferais tant de choses dans le foot. J’étais à des milliards d’années-lumière d’y croire.
Vos affaires personnelles ont eu un impact direct sur le football mondial.
Oui, parce que, là aussi, je cherchais à inventer. C’est moi qui ai inventé les doubles caméras. La caméra dans le but, c’est moi aussi. Claude Bez pourait en parler. Il est là, Claude ! (Il montre le portrait de l’ancien président des Girondins, placé dans son dos.) Contre Hambourg, il donne une prime de 100 balles. Le match d’après, il dit : « Je double ! » Il double, bon, c’est son problème. Quand il fait les comptes, il devait déposer le bilan. Alors, il a fait ce que font tous les autres clubs, il m’a appelé : « Jean-Claude, je suis dans la merde. » Tu sais ce que j’ai fait ?
Non, dites-nous tout.
(Il se lève pour aller chercher une feuille blanche.) Tout ce que j’invente, c’est grâce à l’observation. (Il griffonne un terrain.) Avant, il y avait cinq caméras : une de chaque côté des buts et trois dans une tribune latérale. Je vendais les panneaux de pub qui se voyaient à la télé, le reste, ça ne sert à rien. Alors, pour Bordeaux-Juventus, en 1985, j’ai mis les caméras françaises dans une tribune et les caméras italiennes dans celle d’en face, comme ça, j’ai vendu aux Italiens, les panneaux qui se voyaient. Mais ça, on n’avait pas le droit à cause du signal international. France 2 a dit : « Vous n’avez pas le droit ! » Michel Drucker était embêté, le match allait bientôt commencer. Je lui ai dit : « Pas grave, je ne te donne pas le match. Ce n’est pas à France 2 le stade. » J’ai dit aux Italiens qu’ils n’auraient pas le match non plus. Eux, ils ont payé pour avoir leurs cinq caméras. À un quart d’heure du match, France 2 a payé aussi. J’ai tout vendu et j’ai sauvé le club. T’en connais des gens comme moi ? Il faut y penser hein, il faut être un malade comme moi pour y penser.
Je ne suis pas un mec facile, quand j’étais dans mes droits, je me battais comme un chiffonnier. Je t’accorde que je gagnais souvent.
On vous a justement reproché toute votre carrière d’avoir le monopole…
(Il coupe.) Monopole de quoi ? Le monopole de quoi ? Pas du tout ! J’avais 20 présidents de club avec moi, le président de la Ligue, le président de la Fédération. Ce sont tous des cons ? Ils sont tous corrompus ? Mon influence est celle de quelqu’un qui a fait beaucoup de choses pour eux. Ils avaient confiance en moi. J’ai un contrat de 40 ans avec Jean-Michel Aulas – qui était le plus rotor avec Jean-Louis Campora –, tous les trois ans, il le renouvelait. C’est uniquement parce qu’il m’aimait ? Ce n’est pas faux, il avait beaucoup d’affection pour moi, mais si j’avais pillé son club, il m’aurait dégagé. Je n’avais pas le monopole. J’ai inventé un produit, c’est tout. Le mec qui a inventé la pénicilline a eu le monopole pendant 40 ans. Le mec qui a inventé le viagra, dont je me sers, avait le monopole pendant des années. Tu veux qu’il invente quelque chose et qu’il la donne à tout le monde ? Ça n’a pas de sens.
Comment devient-on crédible après cette invention ? La crédibilité, c’est le plus important. Pour le devenir, il faut respecter sa parole, ses contrats, l’homme qu’on a en face. Je ne suis pas un mec facile, quand j’étais dans mes droits, je me battais comme un chiffonnier. Je t’accorde que je gagnais souvent.
Dans votre bureau, il y a énormément de tableaux et d’objets qui ramènent au passé. Quelle place a la nostalgie dans votre vie ? C’est mon moteur, parce que j’ai plus de rêves que de souvenirs. Je ne veux pas vivre dans le passé, mais il ne faut jamais le renier. Je veux voir devant, parce que je veux vivre. Je me lève tous les jours à 6 heures du matin, même quand je suis fatigué. Quelquefois, je me lève à 7 heures et je perds une heure de vie. Ça me fait rire, les gens qui disent : « J’ai le temps. » Le temps n’existe pas. Le seul temps qu’on a, c’est le présent. Des gens qui sont morts en pleine santé, j’en connais un milliard. Mais je n’oublie rien. Johnny, je rêve de lui, la nuit. Thierry (Roland), il m’arrive de rêver de lui. Il avait une grande affection pour moi, alors que je débutais, que je n’avais pas un rond. Il m’a toujours défendu.
L’écriture d’une autobiographie oblige forcément à revenir sur sa vie. Comment s’est déroulée l’introspection chez vous ? Je suis allé cherché profondément dans mes souvenirs, chez moi-même. Canal va me consacrer un documentaire aussi, un truc de 2 heures, ça n’existe pour personne d’autre. J’ai beaucoup travaillé. Un jour, je me suis réveillé avec un traumatisme d’enfant : quand nous sommes arrivés en Algérie, mes parents n’avaient pas d’argent et nous ont mis dans un orphelinat (avec l’une de ses sœurs, NDLR). Pendant longtemps, j’ai cru que ça avait duré un an ou un an et demi. Je n’avais jamais voulu y penser, je voulais oublier, mais je m’en suis souvenu grâce à ce travail. Je suis allé dans les archives auprès de l’administration. En fait, je suis resté cinq semaines. Mais il reste encore beaucoup de choses à raconter. Je pourrais faire un troisième livre où je parlerais de trial que je faisais dans les rochers, dans la montagne. Je n’ose même pas le raconter, ils vont m’enfermer. Je suis un malade, je suis un fou.
Quel capitaine pour l’OM de Habib Beye ?Propos recueillis par Enzo Leanni, à Paris
"Destin : avoir plus de rêves que de souvenirs" de Jean-Claude Darmon (Fayard, 250 pages, 20,90 euros), en librairie le 3 décembre 2025.