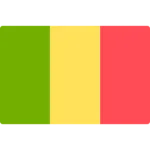Tu as intégré cet été l’UNFP FC, avec d’autres joueurs sans contrat. Comment ça s’est déroulé ?
J’avais déjà effectué le stage à deux reprises, en 2007 et 2013. Désormais, l’encadrement est encore plus professionnel. Il y a toujours eu un entraîneur diplômé et expérimenté qui encadre les stagiaires. Mais aujourd’hui, il y a un adjoint, un préparateur physique. Le staff médical s’est étoffé, avec un kiné-ostéopathe, un masseur… C’est très bien organisé. Avant, on ne faisait pas de tests médicaux les premiers jours. Maintenant, on va à Clairefontaine. On est aussi partis à Malte. On a les mêmes habitudes qu’au sein d’un club pro. C’est mieux que de s’entraîner tout seul à la maison. Je le conseille à d’autres joueurs.
Vous êtes tous dans la même situation, sans emploi : les joueurs sont-ils touchés mentalement ? Ou est-ce que ça soude le groupe ?
Au début, on sent un peu de pudeur et de honte chez les jeunes. Les premiers jours, ils se posent beaucoup de questions. Ils sont même inquiets et tristes. Mais comme moi, je l’ai connu à l’âge de 24 ans, c’est à nous, les joueurs expérimentés, d’expliquer aux plus jeunes qu’il y a des bas dans le foot. Les discours des éducateurs, je pense à René Charrier (vice-président de l’UNFP), sont très positifs. Ça rassure. Les gens apprennent à se connaître, et puis le stage se déroule dans de très bonnes conditions. Tout le monde est content lorsque quelqu’un retrouve un club. Ça crée une dynamique positive. Les gens parlent de « chômeurs du football » , mais l’UNFP insiste sur le fait qu’on est simplement en fin de contrat. On ne va pas se plaindre ! Pour moi, on est juste en stand-by, en fait.
La semaine dernière, tu as pu réaliser un essai à l’ESTAC. Est-ce que ça a été concluant ?
C’est en cours, même si rien n’est signé, ça devrait se faire. En fait, à Troyes, on m’a proposé d’encadrer la CFA. En ce moment, je m’entraîne avec le groupe de Ligue 1, mais ce sera pour jouer en réserve aux côtés des jeunes. À 32 ans, comme j’ai beaucoup bourlingué durant ma carrière, c’est quelque chose qui m’intéresse, même si les gens ne le comprennent pas trop… Quand je dis encadrer, c’est sur le terrain. De plus en plus de clubs font ça : prendre trois, quatre joueurs, pour donner de l’expérience à un groupe frêle et jeune. En plus, Jean-Marc Furlan est un entraîneur qui prône le beau jeu, c’est plaisant. J’ai aussi passé mes diplômes d’entraîneur, donc je songe à l’après-carrière.
Est-ce que ce n’est pas frustrant de s’entraîner avec un groupe qui s’apprête à reprendre la saison au plus haut niveau, alors que toi, tu ne disputeras pas un match en L1 ?
J’ai déjà tenu ce rôle d’ancien au Royal White Star Bruxelles, en D2 belge, cette saison. Comme aujourd’hui, je n’ai pas envie d’arrêter tout de suite ma carrière de joueur, ça reste du plaisir de pouvoir s’entraîner avec un groupe de qualité, dans un club bien structuré, sain et convivial. Je vois ça comme une période de transition.
Malgré les nombreuses expériences que tu as connues durant ta carrière, dans le livre Galère Football Club, tu expliques que tu as passé « les meilleurs moments de [ta] carrière en allant t’entraîner avec les pros du PSG » . Pourquoi tu en gardes un si bon souvenir – même si tu n’as jamais disputé un match de L1 ?
Je n’ai pas réalisé la carrière que j’aurais peut-être pu espérer, mais en y repensant, c’est quand même au sein de ce groupe que j’ai vécu les meilleurs moments de ma carrière. La qualité aux entraînements, le professionnalisme, le sérieux, l’envie et l’état d’esprit… Je n’ai jamais retrouvé ça ailleurs. Souvent, vous entendez des joueurs dire : « On ne fait pas le même métier. » C’est vrai ! Quand on est pro au PSG ou pro en Ligue 2, ce n’est pas le même monde.
Tu supportais le PSG depuis ton plus jeune âge, n’est-ce pas ?
Je suis né en région parisienne, j’ai été formé au Red Star. Mon père était abonné au Parc des Princes. Je me rappelle qu’au stade, il me mettait sur ses genoux. Je n’ai pas vu le fameux PSG-Real, mais je garde en mémoire
la frappe de Vincent Guérin contre Barcelone (en 1995) ! J’avais la chance de voir des PSG-OM, des beaux matchs avec une grosse ambiance : c’est ça qui m’a donné envie de jouer au foot. Le PSG, c’était un rêve, puis c’est devenu un objectif. J’ai eu la chance de vivre avec ce groupe pendant presque un an (2001-02). Je n’ai pas joué avec l’équipe première du PSG, mais c’est la vie. Je n’ai pas de regrets, même en ayant connu par la suite des expériences positives et négatives, je suis content d’avoir vécu tout cela.
Une Indienne donnait des cours de maths à trois enfants, avec des pierres et des allumettes. J’avais envie de prendre une photo, mais par pudeur et par respect, j’ai préféré me rétracter. Ces images me marqueront toute ma vie.
En parlant d’ambiance, tu as connu l’Espagne, la Suisse, la Grèce, Chypre, l’Écosse, la Bulgarie, l’Inde, la Belgique. Dans quel stade as-tu ressenti le plus de frissons ?
En Inde, c’était unique, extraordinaire ! C’était une fête, dans chaque État, on avait l’impression de participer aux Jeux olympiques. Il y avait des feux d’artifices, l’hymne national avant chaque
match d’Indian Super League ! Si tu m’avais posé la question avant, j’aurais répondu : la Bulgarie. Les supporters sont à fond. Là-bas, faut pas mettre tous les supporters dans le même panier. C’est pas parce qu’il y en a dix qui font les cons – ou en emmènent cent avec eux -, qu’ils sont tous à blâmer. En Grèce aussi, ils sont amoureux du football. À l’étranger, les gens sont des fanatiques. Ils peuvent être 10 000, mais poussent comme s’ils étaient trois fois plus.
Tu souhaitais disputer la deuxième édition du championnat indien. Pourquoi ça ne s’est pas fait ? Le FC Goa ne t’a pas recontacté ?
Pour l’instant, je n’ai pas reçu d’offre de contrat, donc pour éviter de me retrouver sans rien… Quand Troyes m’a appelé, je n’allais pas refuser. Comme je l’ai dit, ça m’intéresse aussi. À présent, toute la planète veut participer à l’Indian Super League. Tout le monde a eu un bon retour de la première édition. Que ce soit au niveau sportif, logistique, financier. Ça donne forcément envie à d’autres de venir. Le bouche-à-oreille, c’est rapide.
Au FC Goa, tu as évolué sous les ordres du Brésilien Zico, une vraie légende (71 sélections, 48 buts avec la Seleção). C’est quel genre de coach ?
Un coach très proche de ses joueurs, qui met en place un jeu offensif. On sent qu’il connaît très bien le football. Ses conseils et ses corrections sont pertinents. C’était un honneur d’être entraîné par une telle star, qui fait partie de l’histoire du football mondial. Ma génération, on ne l’a pas vu jouer, mais on a tous regardé la vidéo de
France – Brésil 86. Ce match, on en a parlé. On débattait sur le foot, par exemple pour les penaltys : est-ce qu’il doit y avoir un tireur attitré ? L’attaquant victime de la faute doit-il tirer ? Les coups francs aussi, il en était spécialiste… J’ai beaucoup appris en trois mois.
Vivre en Inde, c’était le plus gros dépaysement de ta vie ?
Totalement. Autant, je m’étais intéressé à l’Inde avant de partir – j’adore la cuisine indienne -, mais sur place, crois-moi, c’est impressionnant. Que ce soit à Mumbai, Delhi, Calcutta, Cochin, on avait le temps de se balader, de découvrir les us et coutumes du pays. On a vu la triste réalité de la misère indienne. Y en a qui vont dire « oui, comme en Afrique » , mais je trouve que c’est même plus marqué qu’en Afrique. Une fois, j’étais arrêté en voiture au feu rouge : il y avait une Indienne qui donnait des cours de mathématiques à trois jeunes enfants, avec des pierres et des allumettes. J’avais envie de prendre une photo, mais c’était tellement dur que, par pudeur et par respect, j’ai préféré me rétracter. Ces images me marqueront toute ma vie.
En 2012, dans une précédente interview à So Foot, tu affirmais que tu ne voulais pas atterrir dans un club de bas de tableau de Ligue 2. Finalement, dans la foulée, tu es transféré au CSKA Sofia, et un an plus tard, tu reviens en France, mais à Mulhouse, en CFA. Qu’est-ce qui t’as fait changer d’opinion ?
Je n’ai pas changé d’opinion. Le CSKA ne respectait pas le contrat, j’ai été payé une seule fois en six mois. J’ai dit stop… Ce n’est pas le moment le plus difficile de ma carrière, parce que j’avais 29 ans. En revanche, quand tu découvres ça étant jeune – comme ça a pu m’arriver en Grèce -, là c’est dur à encaisser. Donc si j’ai signé à Mulhouse, c’est parce que j’ai passé près d’un an sans jouer. Il fallait également valider mes diplômes d’entraîneur. Déjà qu’en France, on ne s’intéresse pas trop aux pays étrangers, alors après presque une saison blanche, difficile de retrouver un club de Ligue 2…
Au cours de ta carrière, tu as souvent ressenti ce manque de confiance en France, au vu de ton CV façonné à l’étranger ?
Chez nous, au regard des recruteurs, dès qu’on quitte la France, on n’existe plus. Quand on discute avec un entraîneur, un directeur sportif ou un président, ils demandent : « Quel est le niveau du pays X par rapport à la France ? Est-ce que ça correspond à la Ligue 1 ? Ligue 2 ? National ? » Ce sont des questions stupides. Du coup, ils vont privilégier un joueur qui joue en France simplement parce qu’ils ne connaissent pas l’étranger. C’est de l’ignorance, en fait. Heureusement, il y a d’autres personnes intelligentes qui recrutent malin.
C’est un mal français ?
Oui. Il y a des Portugais dans toute l’Europe ; quand un entraîneur portugais arrive en poste, il prend des joueurs partout. On se demande pourquoi le FC Porto, Benfica sont plus malins que tout le monde, comment ils font… Ils prospectent dans tous les pays.
Pour l’amour d’El Kaabi et des retournés acrobatiques