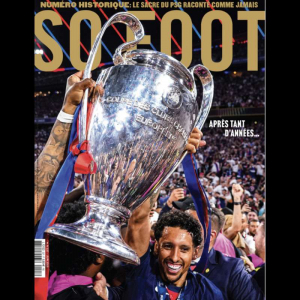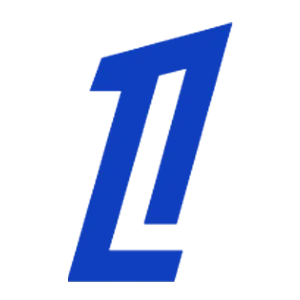- Italie
- Atalanta Bergame
« Le Bergamasque est très fier d’être ce qu’il est, il n’a pas de complexe d’infériorité »

Dans Amare una dea - Aimer une déesse, Cairo, 2024, non traduit -, six supporters de l’Atalanta Bergame décortiquent leur amour pour un club longtemps englué dans le ventre mou du football italien, et désormais habitué des premières places. Que ressent-on quand son équipe se met soudainement à bien jouer ? Pourquoi le club s’est-il mis à gagner ? De quoi l’Atalanta est-elle le nom ? Interview croisée avec deux des coauteurs du livre.
Casting
Davide Ferrario, 68 ans, est réalisateur, scénariste et producteur. Il a notamment remporté un David di Donatello, l’équivalent des César, pour Dopo mezzanotte (2004). Il vient aussi de produire le documentaire A guardia di una fede, qui raconte l’évolution de la curva de l’Atalanta en se concentrant sur son ancien leader, Claudio Galimberti, dit « le Bocia ». Déjà projeté dans plusieurs salles en Italie ou en Allemagne, le documentaire n’est pas encore sorti en France, et n’est pas disponible à la demande.
Gigi Riva, 65 ans, est écrivain et journaliste. Il a été le rédacteur en chef de L’Espresso, l’un des hebdomadaires les plus réputés du pays, et a notamment été correspondant de guerre en Yougoslavie. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont certains ont été traduits en français : J’accuse l’ONU (Calmann-Lévy, 1995), ou Le Dernier Penalty (Seuil, 2016).
Davide, vous écrivez dans votre texte qu’être de l’Atalanta a longtemps signifié « s’arrêter sur le seuil au-delà duquel une fête a lieu, mais à laquelle vous ne serez jamais invité ». L’Atalanta est championne d’Europe en titre, a battu la Juve 4-0 chez elle, reste dans la course pour le titre, bref, fait maintenant partie de la fête. Ça fait quoi ?
Davide Ferrario : Beaucoup de confusion. C’est un fait, nous sommes à ce niveau depuis bientôt dix ans. Ce n’est donc pas un exploit à la Leicester, une seule année et puis s’en va. Mais dans notre culture bergamasque, il nous faut plus de temps pour nous habituer. Rien ne nous est dû. Normalement ce sont les autres qui terminent premiers, les riches, et nous voilà au milieu de tous ces gens-là. Avec tout ça, je crois que nous ne savons plus vraiment ce que nous sommes, comme si nous évoluions dans une sorte de terre du milieu.
Gigi Riva : J’ai maintenant conscience d’être invité au bal, mais je me demande encore de quelle façon je vais être accueilli. En fait, j’ai toujours l’impression de vivre un rêve, mais je n’oublie pas d’où nous venons. Quand on a battu la Juve chez elle 4-0, j’ai vécu ça comme un songe, quelque chose d’inattendu, parce que l’histoire de l’Atalanta est une autre histoire. Une histoire pour laquelle nous avons beaucoup d’affection. Lors de notre seule année en Serie C, il y avait 20 000 personnes au stade : être de l’Atalanta dépasse les résultats sportifs. C’est, avant tout, une question identitaire. En NBA, cela fait sept ans qu’une équipe différente gagne le championnat, parce qu’il y a le salary cap, la draft… Dans la société où le capitalisme est au stade le plus avancé, ils ont compris que pour garantir le spectacle dans le sport, il fallait un équilibre. Cet équilibre n’existe pas dans le football européen. C’est la raison pour laquelle l’Atalanta est révolutionnaire : en partant du bas, elle est parvenue à obtenir des places en Ligue des champions destinées au Milan, à l’Inter, à la Juve, parce que ces clubs ne peuvent pas se permettre de ne pas jouer l’Europe saison après saison. Nous sommes un petit grain de sable, avec les comptes dans le vert, et un entraîneur plus important que n’importe quel joueur. C’est une satisfaction supplémentaire.
DF : J’arrive au seuil des 70 ans, un moment de la vie où l’on fait un peu le bilan. Tout ce qui, je pensais, s’améliorerait d’un point de vue social, politique, humain, a empiré. D’un autre côté, je n’avais jamais imaginé que l’Atalanta devienne ce qu’elle est. De telle sorte que ma vie de supporter m’apprend que les choses peuvent aller dans l’inimaginable. Le football est le seul domaine de ma vie où les choses se sont mieux passées que ce que je pensais. Dans ma famille, par exemple, il y a un garçon partagé entre l’Atalanta et la Juventus à cause de ses parents. Quelques années plus tôt, il aurait fini juventino sans l’ombre d’un doute. Aujourd’hui, il sera pour l’Atalanta, parce que ce n’est plus une équipe mineure.
Il y a toujours eu des groupes pour soutenir obstinément le club de leur ville. Ne pas supporter celui qui gagne, mais celui qui ne gagne que des choses partielles – une promotion, un maintien en première division – donne plus de goût.
Comment définir l’identité du club dont parle Gigi ? Beaucoup de gens à Bergame ont longtemps supporté deux clubs, un gros, puis l’Atalanta, tant remporter un jour un titre semblait improbable.
DF : Mon père était comme ça. Il pratiquait ce que j’appelle la doctrine de la « double foi », commune à de nombreux Bergamasques, selon laquelle tu supportes l’Atalanta presque par inertie, et en même temps, l’une des grandes équipes, pour pouvoir de temps en temps gagner un titre. Lui était milaniste.
GR : Avant, nos victoires étaient nos maintiens, ou nos promotions. En vérité, ce sont des joies tout à fait comparables à la victoire en Ligue Europa. La joie de celui qui gagne la Ligue des champions n’est pas si différente de celui qui remonte en Serie A. Pour comprendre notre identité, il faut aussi avoir en tête la situation géographique de Bergame, à 50 kilomètres de Milan. Nous sommes à côté de deux des plus grandes équipes du monde, que beaucoup de gens nés dans la province de Bergame supportent. Mais il y a toujours eu des groupes pour soutenir obstinément le club de leur ville. Ne pas supporter celui qui gagne, mais celui qui ne gagne que des choses partielles – une promotion, un maintien en première division – donne plus de goût.
DF : Nous n’avons jamais été dépendants de Milan. Il y a une rivière entre nous, l’Adda. C’est une vraie frontière. D’ailleurs, dans Les Fiancés, le grand roman romantique de Manzoni, l’un des personnages fuit Milan pour se réfugier à Bergame, tant il s’agit de deux mondes distincts. Le Bergamasque est très fier d’être ce qu’il est, il n’a pas de complexe d’infériorité.

On a également longtemps défini l’Atalanta Bergame comme « la reine des équipes provinciales ».
GR : C’est un motif de fierté, parce que c’est une forme de suprématie. Parmi toutes les équipes qui luttent pour ne pas descendre, ou bien remonter, nous sommes la meilleure. À Bergame, il y a vraiment une culture du travail bien fait. Quand on fait quelque chose, on tend à le faire bien. Cela s’applique également au football, et cela a permis au club d’être solide structurellement. Le sérieux bergamasque est tel que dans les années 1970 et 1980, les joueurs signaient à l’Atalanta aussi parce que contrairement à d’autres clubs du même niveau, le salaire était versé, et versé à l’heure. C’est aussi ce sérieux, et cette bonne gestion, qui sont à l’origine de notre centre de formation réputé dans toute l’Europe : former des joueurs à la maison coûte moins cher que d’en recruter de l’extérieur. Lors de la victoire en Coupe d’Italie en 1963, l’équipe aligne de nombreux Bergamasques.
DF : C’est une satisfaction, mais c’est aussi un alibi : l’idée de se contenter de la place où l’on se trouve. Gasperini a révolutionné tout cela. Il nous a tous fait passer du « contentons-nous » à « on peut le faire », « on peut oser », « essayons », ce qui n’a rien à voir. Gasperini nous a vraiment fait faire un saut culturel, à tous. Et peut-être que nous sommes vraiment devenus forts. Personne n’aime le Gasp’ à part les Bergamasques. Il a un caractère difficile, et en ce sens, il nous ressemble beaucoup. Nous ne sommes pas sympathiques. Nous ne sommes pas des Romains qui font rire, ni des Napolitains créatifs et sympathiques. Le Gasp’ est en parfaite harmonie avec cela. Il est capable de laisser un joueur célèbre sur le banc, il faut prouver sur le terrain… Nous l’aimons beaucoup.
GR : Gasperini est celui qui change les paradigmes. Avant lui, l’idée était de rester en Serie A, de préserver le 0-0. Gasperini arrive et nous dit : « on peut le faire ». On peut même jouer un foot offensif, pratiquer un football beau, marquer un but de plus que nos adversaires au lieu de défendre. Ce plafond de verre longtemps au-dessus de notre tête, Gasperini nous a montré qu’on pouvait le casser. Il a changé notre mentalité, notre culture. Il faut dire qu’il arrive aussi à Bergame dans un moment charnière pour la ville.
Personne n’aime le Gasp’ à part les Bergamasques. Il a un caractère difficile, et en ce sens, il nous ressemble beaucoup. Nous ne sommes pas sympathiques.
C’est-à-dire ?
GR : Je crois que les succès sportifs surviennent dans les villes lorsque l’environnement y est propice. Quand Gasperini arrive à Bergame, en 2016, la ville occupe les premières places du pays en matière de qualité de vie, de bien-être, ces fameux classement « des endroits où il fait bon vivre ».
DF : Dans les années 1970, Bergame était encore une ville pauvre d’où l’on émigrait. Elle est devenue riche d’un point de vue financier, économique, industriel. L’Atalanta est l’expression de la mutation de cette ville.
GR : Bergame a atteint une sorte de sommet. La ville a plein de raisons d’être heureuse : le centre piétonnisé est magnifique, l’aéroport, autrefois vétuste, est le troisième aéroport d’Italie. Elle commence aussi à devenir touristique, ce qui amène du travail, du business… Voilà le contexte doré dans lequel arrive Gasperini. Et il nous dit : « Nous pouvons arriver premier dans le football aussi. » Il nous montre la voie.
Tout avait pourtant mal commencé pour lui.
GR : Le 2 octobre 2016 est la date à entourer en rouge, le moment où tout change. Gasperini a pris l’équipe en début de saison, et au moment où commence cette septième journée de Serie A, l’Atalanta compte déjà quatre défaites. Le président se demande s’il faut le virer ou non. L’équipe affronte Naples, Gasperini se sait en danger, et lui décide de mettre sur les bancs les joueurs les plus expérimentés pour aligner la moitié du centre de formation. Un message du type : si je dois mourir, je mourrai avec mes idées. On gagne 1-0, on termine le championnat 4es, et le cycle peut commencer.

Vous avez beaucoup insisté sur la notion de travail, propre aux Bergamasques.
DF : C’est une notion très importante qu’il faut bien comprendre : pour le Bergamasque, le travail n’est pas un sacrifice. On travaille dur, oui, mais pour avoir un résultat qui nous honore. Le travail est la réalisation de nous-mêmes et, si l’on s’y met tous ensemble, alors on prendra du plaisir tous ensemble, et on abattra des murs tous ensemble. Une vidéo, qui avait circulé pendant la période du Covid, illustre parfaitement cela. Il fallait construire un hôpital supplémentaire pour accueillir les malades. En une demi-heure, l’info avait tourné parmi les supporters de l’Atalanta qu’il fallait des volontaires pour ériger le bâtiment. Résultat, toute la curva a construit l’hôpital. Les gens travaillaient éloignés les uns des autres, et de temps en temps, ils s’arrêtaient pour chanter à la gloire de l’Atalanta, applaudissaient, et reprenaient le boulot. C’est vraiment l’idée que le travail est une réalisation de soi. Travailler bien est beau en soi, et si cela donne un résultat, alors c’est encore plus beau.
Il y a toujours une fatalité avec nous. Le pape Jean XXIII, originaire de Bergame, est mort le lendemain de notre victoire en Coupe d’Italie en 1963, de telle sorte que notre succès est passé au second plan.
Bergame et sa province ont été l’épicentre du Covid en Europe. On peut presque avoir l’impression que les succès de l’Atalanta sont arrivés pour compenser toutes les souffrances endurées pendant la période.
GR : Je suis trop rationnel pour penser sérieusement cela, mais je le pense un peu quand même. On sait que l’un des facteurs de contamination a été le match de Ligue des champions Atalanta-Valence, à San Siro, de telle sorte que l’un des plus beaux moments sportifs du club est devenu l’un des épisodes les plus sombres de la ville… Il y a toujours une fatalité avec nous. Le pape Jean XXIII, originaire de Bergame, est mort le lendemain de notre victoire en Coupe d’Italie en 1963, de telle sorte que notre succès est passé au second plan, comme cela s’est passé après la victoire contre Valence…
DF : J’étais à San Siro lors du match contre Valence… une fête merveilleuse… on s’en souvient tous, bras dessus, bras dessous, et puis la fête qui bascule en tragédie. Beaucoup de gens sont morts du Covid à Bergame, et qui sait combien l’ont contracté lors de ce fameux match ? Je pense aux supporters disparus et tout ce qui est arrivé depuis… Dans la curva de l’Atalanta, il y a toujours une banderole accrochée qui rappelle « ceux qui ne peuvent pas être là ». Cela inclut bien sûr tous les interdits de stade, mais je crois qu’il est aussi question de tous ces morts.
Puisque vous parlez de la curva, Davide, vous êtes le producteur du documentaire A guardia di una fede, centré sur Claudio Galimberti, dit « le Bocia », ancien leader des ultras de l’Atalanta, et célèbre personnage dans l’univers des tribunes.
DF : À une époque pas si lointaine, l’Atalanta était plus connue pour ses ultras que pour son équipe. Maintenant, le Bocia lui-même dit que l’équipe suffit pour faire parler de Bergame partout dans le monde ! Cet ultra est en tout cas l’un des personnages clés de la ville, et du club, parce qu’il a unifié tout le monde. Au départ, la curva est clairement de gauche, on agite des drapeaux avec le Che, ou des feuilles de marijuana. Ensuite, une bascule s’opère vers la Lega Nord. Lorsque le Bocia arrive, il sort la politique du stade, et fait un vrai travail sur l’Atalanta, et le fait d’être Atalantino. Le réalisateur du documentaire, Andrea Zambelli, fréquente la curva depuis des années, il a donc des images que personne ne peut avoir, ce qui permet au spectateur de suivre l’évolution du virage, et du Bocia, au fil des ans. À un moment, face à la caméra, le Bocia théorise précisément ce qu’il souhaite faire pour unifier tout le monde. Il dit : « Les différents groupes ultras doivent s’unir pour ne former qu’une curva, la curva doit devenir tout le stade, et le stade doit devenir toute la ville. » Tout n’est pas blanc, bien sûr, les ultras de l’Atalanta peuvent aussi être violents, mais les juges qui ont condamné le Bocia reconnaissent sans peine qu’il est un cas à étudier, un vrai leader. Il est en tout cas parvenu à rendre les Bergamasques fiers de leur ville, de leur club, avant même que l’équipe ne connaisse le succès sportif. Ce n’est pas rien.
Le visage balafré de Nikola Krstović après le coup de crampons de Ramy BensebainiPropos recueillis par Lucas Duvernet-Coppola