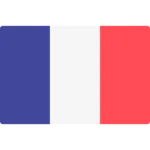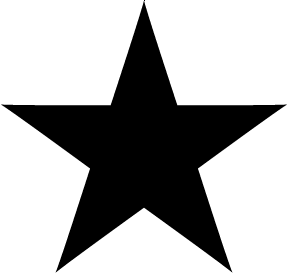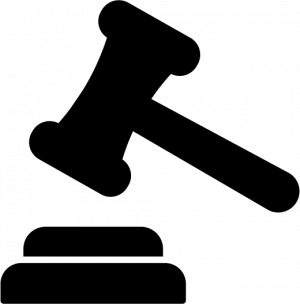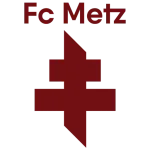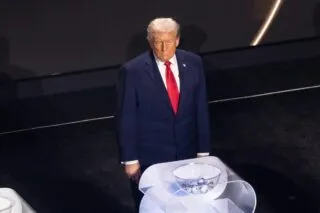- International
- France
Où sont les porte-parole du foot féminin français ?
Sexisme, horaires et lieux bancals, visibilité réduite... Autant d’obstacles que le football pratiqué par les femmes continue de subir. Pour franchir un cap, il est désormais nécessaire de trouver des figures de proue, une Rapinoe à la française, pour porter un message mais aussi véhiculer des valeurs. Si tant est qu’on veuille bien les écouter.

« J’ai envie de dire que le sport féminin est peut-être l’avenir du sport. » Ceci n’est pas une paraphrase de Jean Ferrat, mais les propos préliminaires de Gilles Galinier, directeur de la communication d’Arkema, sponsor principal de la Première Ligue, lors de l’événement « Femmes capitales, Célébrer la place des femmes sur tous les terrains, ceux du sport comme de l’entreprise ». Une petite sauterie organisée au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain et son partenaire Deloitte, cabinet de conseil international. Parmi la myriade de thématiques abordées lors de la table ronde, un sujet a longtemps été abordé : la question du poids de la parole des sportives de haut niveau, dont les footballeuses, dans l’espace médiatique et politique.
Trouver la tête d’affiche du foot féminin français
Micro à la main, ton ferme pour tenir en haleine la centaine de personnes présente dans la salle, la cycliste médaillée d’or aux Jeux paralympiques de Paris 2024 Marie Patouillet exprime son vœu : « J’attends qu’en France, on ait une Serena Williams, qu’on ait une Megan Rapinoe, qu’on ait une Naomie Osaka, qui ose prendre la parole, qui devienne un modèle par ses performances, mais également pour ses prises de position. » Une personnalité souhaitée qui n’a encore pointé le bout de son nez dans l’Hexagone, et encore moins dans le football. Cassandre Beaugrand (triathlon), Clarisse Agbegnenou (judo) ou encore Pauline Ferrand-Prévot (VTT) sont par exemple des figures reconnues et respectées, mais qui peinent à s’imposer comme des porte-parole. Côté ballon rond, Wendie Renard, Eugénie Le Sommer ou Sakina Karchaoui sont aussi identifiées, mais sortent rarement du cadre du terrain.
Si demain, on donne le champ libre à une sportive, elle va d’abord ressentir de la peur et questionner sa légitimité, si elle peut prendre la place qu’on lui donne.
Malheureusement à l’image de la société, ce sont majoritairement les hommes qui éprouvent le plus de facilité pour prendre la parole, mais aussi pour être écoutés. L’an dernier, on a par exemple entendu certains joueurs de l’équipe de France masculine prendre publiquement la parole pour parler politique nationale, exprimant haut et fort leurs opinions. Pour Marie Patouillet, « aujourd’hui en tant que femme, on n’a pas l’espace (pour prendre position). On a peur de la prendre, cette place-là. J’ai envie de dire que c’est même pire : on ne sait pas la prendre. Ça veut dire que si demain, on donne le champ libre à une sportive, elle va d’abord ressentir de la peur et questionner sa légitimité, si elle peut prendre la place qu’on lui donne. » Un constat partagé par Michelle Gilbert, directrice de la communication du PSG, qui lui répond d’une voix enjouée : « La légitimité. Je pense que c’est un mot très important. Les femmes se demandent : “Est-ce que l’on peut dire ce que l’on pense ? Est-ce que l’on est à notre place de donner notre opinion ?” Ce sont des questions qui reviennent souvent. »
Plusieurs facteurs en cause
Mais alors, comment expliquer ce manque d’affirmation ? La sociologue du sport et ancienne handballeuse professionnelle Béatrice Barbusse soulève trois éléments de réponse. « Premièrement, c’est dû à la culture française. On est dans un pays particulièrement conservateur, notamment à propos des femmes et de leurs droits. Je rappelle que l’on est l’un des derniers pays en Europe à avoir donné le droit de vote aux femmes (1944, NDLR). De ce point de vue, je ne suis pas étonnée que l’on n’ait pas d’icône sportive qui prenne position sur des faits les concernant. » Elle poursuit en pointant du doigt le contexte sportif imposé aux joueurs, hommes et femmes confondus, où « on leur apprend à se concentrer uniquement sur leur sport et leurs performances. À chaque fois qu’un ou une sportive de haut niveau ose prendre position sur des choses, on leur répond qu’ils ne sont pas à leur place et qu’ils doivent se taire. » Une référence à certains débats récents comme lorsque le judoka Teddy Riner a eu le malheur de monter au créneau en s’opposant à l’interdiction du port du voile dans le sport, de quoi s’attirer d’innombrables critiques de l’opinion publique.
Si même l’une des personnalités préférées des Français s’attire les foudres de la sorte, on imagine l’anxiété d’autres athlètes à l’idée d’oser prendre la parole publiquement. Parce que moins réputés ou cornerisés dans des environnements aux règles inflexibles. C’est un peu le cas pour le football, à entendre la sociologue Béatrice Barbusse, qu’elle considère comme un « environnement extrêmement sexiste, machiste, et où, là aussi, on fait bien comprendre à ses pratiquants qui a le droit d’ouvrir sa bouche et qui ne peut pas ». Un climat de peur qui explique qu’il est « tout à fait logique que, socio-culturellement parlant, on n’ait pas de footballeuse française porte-parole comme Megan Rapinoe, bien qu’elle ne soit pas la seule. On a donc un entremêlement de raisons macro-culturelles qui fait qu’on se retrouve avec peu d’organisations, peu de mobilisations. » Un effet entonnoir – société, sport, football – à la genèse de cette absence de taille.
Cachez ces femmes qu’on ne saurait voir
Pour ne rien arranger à ça, leur exposition n’est pas toujours optimisée. En attestent les horaires d’événements décisifs parfois fixés à la manière d’un match de district. La finale de la Coupe de France féminine entre le PSG et le Paris FC, deux clubs d’envergure, est prévue le samedi 3 mai (dans un week-end suivant un jour férié) à Calais et à 15 heures. Si on voulait la cacher, on ne s’y prendrait pas autrement. Conséquence directe, un manque de visibilité criant qui n’aide pas le football féminin à évoluer. L’internationale française Grace Geyoro, milieu du Paris Saint-Germain et témoin de la table ronde, regrette cette décision prise par la FFF : « On aimerait que ça évolue. C’est toujours cette notion de prouver que l’on mérite de jouer dans de grands stades, de jouer à des horaires où tout le monde peut regarder nos matchs qui revient. On se doit de le démontrer. »

Cette place, elles passent leur vie à se battre pour l’obtenir. Outre les classiques remarques sexistes du style « c’est un sport de garçon », « c’est pas beau les cuisses musclées », ce sont par les actes que ce manque de reconnaissance se traduit. C’est ce qui est arrivé à l’ancienne star du PSG Laure Boulleau à ses débuts dans la capitale au milieu des années 2000 : « Les personnes responsables du centre de formation des garçons de l’époque refusaient de nous laisser l’accès à la salle de musculation. Sauf qu’on s’entraînait le soir, donc il n’y avait personne, ça n’aurait rien changé pour eux. On ne respectait pas notre football. » Une frontière qui s’est depuis estompée. « Au centre de Poissy, parfois hommes et femmes sont ensemble et ça ne pose aucun souci », poursuit l’actuelle consultante de Canal+.
La solution est entre les mains des sponsors et des syndicats ?
Pour accélérer les choses, une solution pourrait aider : l’argent. Pour Marie Patouillet, que l’on soit footballeuse ou pas, le gain de crédibilité des sportives passe par la case sponsors. « J’étais l’une des premières athlètes paralympiques à signer des contrats avec des grosses entreprises. Quand j’arrive avec ces étiquettes de marque, sans même ouvrir la bouche, je sens que j’en impose. Le regard des gens change quand on arrive avec de si gros sponsors. » Un game changer qui a fait aussi ses preuves dans le football féminin. Pour Marie Patouillet, le sponsoring est – au-delà d’une bouffée d’air frais pour les finances – une clé pour ouvrir d’autres portes : « C’est aussi par là que les médias vont changer. Le jour où les marques mettront des millions sur plusieurs sportives, comme pour les hommes, ils se demanderont pourquoi les entreprises investissent autant sur nous. Et c’est là qu’ils se diront qu’on a des choses à raconter, qu’ils s’intéresseront à nous. »
Si on n’est pas vues, on ne peut pas inspirer, on ne peut pas donner un modèle. Je plaide pour que les médias nous suivent. Il faut faire parler de nous, qu’on montre les talents qui sont là.
En bref : pour identifier ces sport-symbol, il faut de la visibilité, chose que développe Michelle Gilbert. « Si on n’est pas vues, on ne peut pas inspirer, on ne peut pas donner un modèle. Je plaide pour que les médias nous suivent. Il faut faire parler de nous, qu’on montre les talents qui sont là. » Cette volonté est également celle des joueuses. Les Parisiennes collaborent régulièrement avec différents influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux. Dernier exemple en date, les petits jeux avec le créateur de contenu Tony Czech début mars. « On se tourne vers eux pour toucher une autre audience. Nos joueuses ont envie d’en faire plus avec les médias, plus avec les fans, elles veulent être actrices de leur propre destin », ajoute la communicante.
Au-delà de l’aspect financier, Béatrice Barbusse évoque des moyens davantage tournés vers l’humain. « Si les syndicats français étaient davantage des syndicats de participation que de service, ça permettrait de faire évoluer les causes. On aide les sportifs à gérer leur patrimoine, leur reconversion… et moins dans la revendication. » Cela passe donc par la syndicalisation des footballeuses, pour l’heure pas assez « acculturées à porter des revendications » regrette la sociologue. En 2018, Eugénie Le Sommer avait ouvert la voie en devenant la première femme élue au sein du comité directeur de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP). L’attaquante de l’Olympique lyonnais en est ensuite devenue la directrice générale en novembre 2020. Une fonction qui lui avait valu le surnom de « La Syndicaliste » dans le vestiaire des Bleues. Selon Béatrice Barbusse, il faudrait aussi que, tous sports confondus, les femmes prennent la parole en même temps sur des problématiques communes. Par exemple, celle de la maternité ou des conventions collectives. « À ce sujet-là, j’ai vu des sportives en parler, mais JAMAIS avec une force collective. Tant que les sportives porteront des problématiques de façon individualiste, elles ne bénéficieront pas des résultats qui peuvent être amenés par une force collective », ponctue l’ancienne handballeuse.
Les problèmes existants sont ciblés, et les potentiels facteurs pour les pallier aussi. De quoi donner de l’espoir à ce football féminin en pleine croissance. « Je suis contente de voir comment ça évolue, déclare sourire aux lèvres Laure Boulleau. Je pense que le foot féminin est plutôt bien loti, mais on n’est pas encore à la fin du processus, on est au début. On a passé l’introduction et la première partie, mais il reste au foot féminin français encore plein de choses à faire ! » Et pas seulement exploser ce foutu plafond de verre des quarts de finale en tournois internationaux.
Delphine Cascarino quitte son clubPar Quentin Toneatti, à Paris
Propos recueillis par QT, lors de l’événement « Femmes capitales » organisé par Deloitte et le PSG au Parc des Princes.