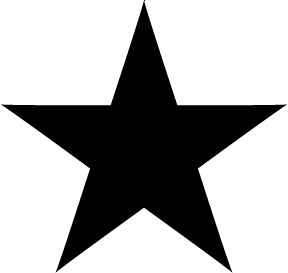- Culture Foot
- Médias
Claude Askolovitch : « La vérité, c’est que je ne comprenais rien au jeu »

Titulaire de la revue de presse de la matinale de France Inter depuis huit ans, Claude Askolovitch a décidé de ne pas prolonger pour ménager sa santé. Les dernières indiscrétions du mercato l’annoncent à la rentrée dans une émission d’access prime time chez un promu de la TNT, Novo19 (la chaîne d’Ouest-France). Puisque changer de club est toujours l’occasion de faire le point, l’Asko s’est assis pour raconter son expérience du journalisme sportif et s’interroger sur ses choix de carrière.
Est-ce que le sport faisait partie de l’éducation, chez les Askolovitch ?
Je dois avoir 9 ans quand mon père m’amène la première fois à Bauer – qu’on n’appelait pas Bauer à l’époque, on disait qu’on allait au Red Star ! On habitait aux Batignolles, tu prenais le métro place Clichy, direction mairie de Saint-Ouen, et voilà. Le Red Star était le seul club de Paris en première division. C’était la saison 1971-1972 je pense, on gagne 3-1 contre Ajaccio. À l’époque, il n’y a pas de tribunes en dur derrière les buts, c’est une butte en herbe. Le deuxième match auquel j’assiste, on ne marque pas, et je suis très malheureux intérieurement parce qu’il y a des gens qui râlent contre « mon » Red Star, il y a même un mec qui dit « je vais aller voir le basket, au moins y aura des paniers ». Le Red Star jouait plutôt le bas de tableau, mais il y avait Christian Laudu aux buts, il y avait Garrigues arrière droit…
Ma mère est hollandaise, d’une famille juive allemande réfugiée aux Pays-Bas, et ses parents habitent pas loin du stade olympique d’Amsterdam. Donc l’Ajax, c’est à moi, c’est l’équipe de ma deuxième ville.
Et tu regardes le foot, à la télé ?
Il y en avait très peu. Je me souviens qu’on voyait les buts allemands dans Stade 2… Je rate le Brésil 1970, je ne suis pas assez grand pour qu’on me laisse regarder la nuit. Mais à partir de 1971, 1972, je regarde l’Ajax en Coupe d’Europe. Ma mère est hollandaise, d’une famille juive allemande réfugiée aux Pays-Bas, et ses parents habitent pas loin du stade olympique d’Amsterdam. Donc l’Ajax, c’est à moi, c’est l’équipe de ma deuxième ville. Et elle gagne tout, donc forcément, je comprends pas pourquoi les Pays-Bas perdent en 1974 cette finale contre l’Allemagne… Ce sont des attachements un peu sentimentaux, des patriotismes pas très rationnels ou logiques, au contraire : l’aventure de Bastia, en 1978, je suis à fond derrière parce qu’il y a Johnny Rep, et qu’il est à moi, tu vois ? Je suis à fond le Tour de France aussi, et j’étais pour Joop Zoetemelk, parce que Hollandais marié à une Française – on a fait plus tard des sorties en vélo avec un pote à Germigny-L’Évêque, où il habite, en espérant le voir pour lui embrasser les pieds. Je me souviens l’été 1980, quand Hinault a abandonné sur le Tour, que Joop est en jaune et que l’équipe qu’il a abandonnée, Mercier, a une bourre pas possible et manque de le faire vaciller. Il tombe à un moment donné, et il est sauvé par Van der Velde qui va l’emmener. Je me dis « il n’y arrivera jamais », et si, il gagne enfin le Tour de France. Quand j’ai commencé à bosser comme journaliste, et que je vois à la télé Zoetemelk champion du monde en 1985, à 39 ans… honnêtement, c’est des émotions qui me submergent. Et comme tout le monde, j’avais été embarqué au collège par les épopées de Saint-Étienne. (Il cite en rafale l’équipe type, NDLR.) Je ne comprends toujours pas comment Stéfan Kovács sélectionne en équipe de France Repellini et Mercadier alors qu’ils sont barrés en club par Janvion et Lopez !
Et tu suis le sport aussi dans la presse écrite que tu affectionnes tant ?
Mon premier souvenir, c’est mon père qui m’avait acheté un hors-série de L’Équipe de 1966 qui s’appelait La Coupe à 50 ans. Je l’ai appris par cœur, et je le connais toujours par cœur – je suis un peu autiste et hypermnésique. Quand je lis un truc, je ne l’oublie pas. Donc je connais l’histoire de la Peugeot offerte à Étienne Mattler et aux Sochaliens vainqueurs de la Coupe de France 1937, ou la défense héroïque de Charleville avec Julien Darui et Helenio Herrera qui ne perd que 1-0 face au grand Racing en 1936. Je peux te parler comme si j’y étais, aussi, de la finale 1921, quand Lucien Gamblin, capitaine du Red Star, arrête de la main un tir de Devaquez de l’Olympique de Pantin. Et Chayriguès, le gardien de but du Red Star, va arrêter le penalty de Devaquez. (Le Red Star gagnera la première de ses trois coupes de France d’affilée, 2-1, NDLR.) Il y a quelques dingues dans les journalistes de foot, et mon ami Didier Braun, qui l’est peut-être encore plus que les autres, a consacré une biographie à Pierre Chayriguès. C’est merveilleux ! Et alors mon père m’achète assez vite tous les ans L’Année du football, le gros bouquin de Jacques Thibert, et parfois aussi Miroir du football, le canard communiste, très idéologue, avec des théories sur la défense en ligne qui serait de gauche par opposition au marquage individuel. C’est rigolo d’ailleurs : au rugby, les aristocrates, la droite, ce sont les arrières, mais les avants, le bleu de chauffe, c’est la gauche.
Et tu y joues, au football ?
Je suis nul à la récré, je suis gros, je réfléchis beaucoup trop avant de faire des trucs. Le club du coin, c’est l’US Pouchet, où joue un pote bien meilleur que moi. Est-ce que j’y ai pas joué, moi aussi un peu, avec ce maillot rouge et noir ? C’est possible… Je fais mon collège et mon lycée à Chaptal, en sixième je joue en UNSS, je suis mauvais, puis après la seconde on va s’entraîner sur les terrains du stade de l’avenue Amiral Bruix, derrière la porte Dauphine. Là, je suis un peu moins mauvais, mais j’ai jamais été bon… Tu sais, j’ai commencé ma carrière comme journaliste sportif, mais la vérité, c’est que… je ne comprenais rien au jeu.
Quand je joue ou que je regarde le foot gamin, et même ensuite, je me rends compte que je n’ai pas l’œil, qu’il y a des choses que je ne vois pas. Moi, le foot, je l’aime comme j’aime la peinture, comme un objet, sans comprendre le coup de pinceau, si tu veux…
Allons bon.
Non mais je te jure, quand je joue ou que je regarde le foot gamin, et même ensuite, je me rends compte que je n’ai pas l’œil, qu’il y a des choses que je ne vois pas. Mon quasi-frère Philippe Broussard, que je rencontre pendant mes études, il voyait tout, à la télé, dans le stade, et c’était un bon joueur sur le terrain. Moi, le foot, je l’aime comme j’aime la peinture, comme un objet, sans comprendre le coup de pinceau, si tu veux… C’est la multiplication des matchs à la télé, et son traitement dans la presse qui fait que la culture foot « technico-tactique » de mes fils, par exemple, est très supérieure à la mienne. Pour te donner une idée, dans mon papier sur la finale de la Coupe du monde 1986 pour Le Matin de Paris, j’ai quand même écrit que Maradona n’est pas impliqué sur le dernier but de l’Argentine, alors que c’est lui qui a fait la passe lumineuse à Burruchaga.
Tu parles de Philippe Broussard, qui publiera en 1990 un livre culte, que So Foot a d’ailleurs réédité, Génération Supporters.
Oui, ça avait été un énorme truc, la sortie de ce bouquin. Moi, j’ai pas appris grand-chose parce que Philippe m’avait déjà tout raconté ! Et surtout, j’avais été témoin de sa passion pour ce phénomène du supporterisme. Quand on est étudiant au CFJ, Philippe me dit : « Allez, viens, on va à Liverpool. » Et ça forge notre amitié. C’est Philippe qui m’a dépucelé ! T’as toujours dans les amis qui vont au bordel un mec qui n’y est jamais allé. Bah moi je suis celui-là. Je ne suis pas un courageux, je suis un pétochard même, j’aime pas les bagarres. Mais je vais y aller quand même, dans le kop, et rencontrer les supporters, parce que je veux pas me dégonfler devant mon « frère », je veux l’épater. Donc on découvre tout ça et waouh… On est étudiants, on vend des papiers à Onze Mondial et au Matin de Paris, où on se fait embaucher avec deux autres amis à la fin de l’école en 1985, dans un service des sports un peu autogéré. Donc le foot va devenir mon métier un peu par hasard, j’étais pas destiné à ça, c’est la rencontre avec Philippe qui fait que… Moi, je m’intéressais à plein d’autres trucs.

Le phénomène du hooliganisme, c’est une façon très transversale, politique et sociétale de traiter du foot.
Oui, et j’en ai fait plein de mon côté, des histoires de hooligans, j’apprends à leur parler, ce sont des histoires qui m’intéressent, ça me fait marrer… En 1987, j’avais fait par exemple un reportage sur les hooligans néonazis du Dynamo Berlin, j’avais fait un déplacement à Leipzig avec eux… Ils n’avaient rien contre les juifs – c’était mieux ! –, mais ils en avaient après les Turcs, et ils citaient Goebbels. Mais disons qu’à un moment, j’ai lâché l’affaire. Philippe, non. C’est un taré : pendant la Coupe du monde 2006 que je suis pour L’Obs, à faire des beaux papiers pour le site, des grandes sagas ; lui il est là pour Le Monde. On a quand même 44 ans tous les deux, et après un match, je dis « allez, on va bouffer ? » Bah non, il m’emmène dans les rues près du stade de Dortmund suivre les mecs, avec les flics qui balancent des lacrymos. « Mais tu me casses les couilles ! Tu sais que je vais t’accompagner, mais tu m’emmerdes ! » Moi en 2006, je suis très bon pour raconter Willy Sagnol, le comparer à un poilu de 14-18, ou expliquer le dévouement de Malouda, qui accepte d’être le premier défenseur des Bleus… En 2008, j’avais suivi les ultras du PSG du kop Auteuil pour le déplacement à Sochaux, avec le but d’Amara Diané qui nous sauve. Les mecs se détruisent à la bière et aux shots de vodka avant d’arriver au stade pour se remonter. Je me souviens d’un gars qui dirigeait les Falcos ou les Supras, je sais plus, qui était éboueur à la Ville de Paris… C’est ce genre d’histoire que je sais raconter, dans le foot. Quand je découvre Liverpool avec Philippe, que je vais dans les pubs et que les mecs me racontent la ville, me parlent de Dixie Dean, le meilleur buteur de l’histoire d’Everton dans les années 1920 et 1930, ça m’intéresse. J’aime bien raconter ça. Mais comment on joue au foot, à l’époque, I don’t give a shit ! J’ai commencé à comprendre un peu mieux bien plus tard, à 50 ans.
Comment ?
Bah, je me retrouve au chômage pour une histoire compliquée, Charles Biétry me tend la main, et je me retrouve à Bein Sports pendant trois, quatre saisons, avec Alex Ruiz. Et là, pour moi, c’est une catastrophe : je réalise mon incompétence totale. Omar da Fonseca et Sonny Anderson voient bien que je suis un handicapé du ballon, et ils m’expliquent le jeu !
Et pour une fois, nous l’avons emporté, cet Euro 1988, et quand on élimine la RFA en demi-finales, je fais un high five avec Rijkaard et un doigt d’honneur au public de Hambourg, dont j’ai encore honte aujourd’hui.
Après Le Matin, tu fais partie de l’aventure du quotidien Le Sport…
Oui, en 1987-1988, et là, je suis l’Ajax, les Pays-Bas, génération Gullit, Van Basten, je leur parle, je connais, j’ai leur âge, je comprends ce qu’ils ressentent par rapport à l’Allemagne, la grande histoire de la guerre, et la finale de la Coupe du monde qu’ils auraient dû gagner en 1974. Et pour une fois, nous l’avons emporté, cet Euro 1988, et quand on élimine la RFA en demi-finales, je fais un high five avec Rijkaard et un doigt d’honneur au public de Hambourg, dont j’ai encore honte aujourd’hui. Je passe beaucoup de temps avec Rinus Michels, aussi. Pour moi, une espèce de dieu : le mec a construit l’Ajax. Il est entraîneur des Pays-Bas en 1974, et revient quatorze ans après, à 70 ans, et ils sont champions d’Europe avec lui, leur seul titre. Une équipe incroyable qui se fait pourtant taper par la Russie au premier match, celle de Dassaev, Belanov, Zavarov !
Au Sport, votre correspondant à l’OM est un certain Pape Diouf.
Pape, avec Broussard, on le connaissait d’avant… Je l’avais rencontré la première fois que j’étais descendu à Marseille pour Le Matin de Paris, un match de présaison, juste après que Tapie a repris l’OM, en 1985. Je vois ce grand gars qui travaille pour La Marseillaise, beau comme un as, un pur intello du tiers-monde qui a toute la collection des Temps modernes dans sa bibliothèque, qui fait des phrases posées, avec une langue exquise, et qui m’appelle « mon petit » alors qu’il doit avoir huit ans de plus que moi. Il me ramène de La Ciotat ou Martigues dans sa bagnole, et il fumait des pétards, je tire dessus et… en arrivant, je suis tellement cassé qu’il croit que je vais me noyer dans le Vieux-Port ! Après Le Sport, ensuite, quand Pape devient agent, il s’occupe de Basile Boli, le héros de la Coupe d’Europe 1993. Évidemment, Bas’ va faire un bouquin. Pape se dit : « Le premier qui m’appelle entre Philippe et Claude, je lui file le bouquin à écrire. » Le hasard a fait que c’est moi qui l’ai appelé le premier. Mais je pense que Philippe n’aurait pas voulu, parce que supporter du PSG, parce que l’OM, et parce que Tapie le débectait, surtout. Et il avait raison, Tapie était débectant. Mais Basile, c’était marrant à faire. Il m’a raconté les bringues qu’il faisait avec Waddle, pétés comme des coings, mais pas seulement. Basile avait un regard sur l’époque, sur son père, sur ce qu’il convient de faire.
Quand tu signes ce livre, Black Boli, en 1994, tu as depuis longtemps quitté le journalisme sportif pour suivre la politique et la société. Pourquoi ?
Je pense que je sais que je n’ai pas le bagage technique et tactique. Puis, il y a une part de hasard, d’opportunités de carrière, une passion ancienne pour la politique, militant à l’Unef, tout ça. Ce n’était pas par snobisme, enfin, je ne sais pas si j’ai été attiré par le miroir aux alouettes ou non… Alors j’ai continué à couvrir le sport, hein, pour la presse généraliste, les grands événements, mais pas beaucoup, pas assez. Tu vois, je fais les JO de Barcelone et d’Atlanta, mais pas ceux d’Athènes par exemple, et c’est un regret, pourquoi je n’y suis pas ? C’était vraiment pour moi, ça, c’est magnifique… Mais la Coupe du monde 1998, par exemple, je suis à Marianne, et ils ne me voient pas pendant un mois, à la rédaction. Je vois tous les matchs de la France, des Pays-Bas, de l’Argentine et du Brésil. C’est l’époque de l’affaire Festina, le football est pur. (Il se marre.) Quel pied c’était, putain ! Surtout, à chaque fois qu’en presse généraliste je reviens couvrir le sport, je retrouve mes potes « d’enfance ». Et puis il y a tellement d’histoires à raconter, dans le foot. Marianne Mako, que j’adorais, avait fait un bouquin sur les joueurs de l’équipe de France 1998. Énormément d’entre eux ont été endeuillés jeunes, à perdre un frère, comme Deschamps, Desailly, Petit. Et Aimé Jacquet, c’est une histoire qui reste encore à raconter.

Comment ça ?
J’adorais Jacquet, quand j’étais jeune journaliste sportif. Et je le vois être détruit par Claude Bez. Je le revois en train de donner une interview à des journalistes, j’étais derrière lui et je vois ses mains, il se les triturait, les déchirait d’angoisse, d’anxiété. Le mec a gagné trois championnats avec Bordeaux, et si Vujović ne rate pas son penalty contre Leipzig en 1987, ils vont en finale de la Coupe des coupes. Mais il se fait virer de façon horrible, et à nouveau ensuite par Nicollin, devant tout le monde, à Montpellier, où il va se planter. Aimé, il n’était pas si vieux hein, et il est à la rue. Il a 50 ans, l’âge que j’ai quand plus tard je me retrouve au chômage, donc a posteriori, ça me parle. C’est dur. Et puis il y a cette élimination contre la Bulgarie, en 1993, et il revient. Je suis épaté, mais je n’y crois pas. Parce que je reste dans l’image d’un mec qu’on a cassé. Je le sens fragile. Un jour, il emmène l’équipe de France, en Pologne, visiter Auschwitz (en novembre 1994, NDLR). Et je lui dis : « Mais tu es sûr, moi tu m’emmènes voir Auschwitz, je suis plombé, j’ai pas envie de jouer au foot. » – « Ah, tu penses qu’il ne faudrait pas y aller? » Comment Aimé Jacquet peut me demander mon avis, à moi? Tu vois ce que je veux dire ? Trop gentil. J’arrive pas à croire qu’il va y arriver ! Mais quelle rédemption ! On a dit « L’Équipe salaud, salaud de Bureau, salaud de Ejnès ! » C’est mes amis, ces gens, hein… Mais comment ce mec qui avait été détruit par Bez, puis par Nicollin s’est remis en selle, on ne l’a jamais vraiment raconté. C’est un truc de fou ! C’était ça ou crever. Il n’a que 57 ans en 1998… et il arrête !
Quand tu te retrouves tout jeune diplômé de journalisme au Matin de Paris, c’est une spécialité respectée dans la rédaction, les sports ?
C’est plutôt une rédac jeune, des mecs qui aimaient le sport. Nous, on avait entre 23 et 25 ans. Il n’y a pas de condescendance, on a de la place. Ils nous gueulent dessus parce qu’on rend en retard, ce qui est normal. On est encore à l’époque où tu fais les comptes rendus de match et tu risques de faire une crasse dans ta chute parce que ça boucle et que le match est pas terminé, tu vois ? Mais ça se passe bien. Le Matin de Paris a été créé par Claude Perdriel en 1977 pour soutenir la gauche, mais en même temps, t’as aussi des gens qui viennent de France Soir, donc il y a une culture de journal populaire, de presse sportive. Alors, c’est un traitement plus classique que celui de Libé qui, à l’époque, réinvente le genre. Patrick Le Roux, Christian Jaurena, Laurent Rigoulet, Jean Hatzfeld… C’étaient des stars, les mecs. On les côtoyait sur le terrain, mais ils avaient une manière de faire à eux, ils avaient leurs angles, ils savaient qu’ils étaient Libé. Ils étaient les premiers à raconter des histoires tout en osant aussi parler technique.
C’est drôle parce que Platini, c’est un mec qui a plutôt laissé entendre qu’il est de gauche, mais pour moi, c’est un anar de droite, un personnage de Roger Nimier. C’est le copain de droite qu’on a envie d’avoir : cool, intelligent, arrogant, pas à sa place…
Tu as quels souvenirs de tes premières compétitions, à te retrouver à être un « suiveur », accéder aux joueurs ?
Alors, je t’ai dit que j’avais été à fond derrière Saint-Étienne, mais quand Platini y arrive… J’aime moins Platini qu’il ne le faudrait, parce que j’aimais bien Nice, et Nancy a battu Nice en finale de la Coupe de France. C’est des trucs bizarres, hein ?
Tu aimais Nice pour Guillou ?
Non, Nice pour Nice, me demande pas, mais sûrement parce qu’ils ont un maillot rouge et noir comme l’équipe de mon quartier, Pouchet. De la même façon, quand le Red Star quitte l’élite, je ne suis pas pour le PSG parce que je lui reproche d’avoir pris la place du Red Star. Je suis le PSG, mais je ne suis pas supporter jusqu’à ce que je me retrouve au stade en 2004 quand Pauleta marque ce but extraordinaire à Barthez : il lui fait un leurre, l’aspire vers lui et s’en va le lober du milieu de la ligne de corner. Quelle ruse, quelle intelligence géniale. Mon grand garçon qui a alors 9 ans, il voit ça à la télé, il m’appelle, et me dit : « Je veux le maillot de Pauleta. » Donc forcément, quand mon fils en tombe amoureux, je suis PSG. Mais ce serait mentir que de dire que j’ai été PSG depuis le début, même si je peux tout te raconter, hein : Valenciennes, la montée, et tout. Philippe Broussard, lui, il pourrait dire que c’est le plus vieux supporter du PSG au monde ! Quand je commence dans le journalisme, le PSG est champion en 1986, donc c’est fort, t’as Borelli, les feujs, les tunes (les juifs tunisiens) c’est marrant, mais t’as déjà aussi les hooligans nazis… Bref, PSG, j’aime bien, je tourne autour, mais je suis pas à fond. Et quand le Racing revient en D1 avec le Matra, j’aurais voulu qu’ils y arrivent, parce que le Racing, c’est le club que supportait mon père dans sa jeunesse… Ma première femme, qui est décédée prématurément, la mère de mes grands enfants, quand on était en train de tomber amoureux, en septembre 1989, je l’ai emmenée voir un PSG-Racing au Parc… Pour te dire quand même, comme le foot faisait partie de ma vie, mais je picorais, quoi ! Aujourd’hui, je suis un peu plus à bloc ; je peux te dire que l’aîné de mes deux petits garçons, que j’ai eus avec ma deuxième femme, est né la nuit du premier match de Zlatan au PSG, un 12 août. C’est aussi l’anniversaire du PSG et de François Hollande, d’ailleurs !
Mais j’y reviens : tu avais quoi, contre Platini ?
Rien. Attention, moi quand je débarque à suivre les Bleus et qu’il y a Platini, en 1985, 1986, je tremble. C’est drôle parce que c’est un mec qui a plutôt laissé entendre qu’il est de gauche, mais pour moi, c’est un anar de droite, un personnage de Roger Nimier. C’est le copain de droite qu’on a envie d’avoir : cool, intelligent, arrogant, pas à sa place… Un mec intéressant, non ? Il dégage un truc d’une droite que j’aime : faut pas le faire chier, l’aristocratie… Il est stendhalien, non ? Mais il a dîné avec le diable, ensuite, avec Blatter. C’est génial ! De la vraie politique. La manière dont finalement il tombe, elle est horrible. Mais quand je couvre le foot comme jeune journaliste, je ne suis pas pote avec Platini. Je peux être pote avec les mecs de la génération après, William Ayache, Sylvain Kastendeuch, Yannick Stopyra, dont Philippe Broussard était très proche aussi, des mecs tourmentés, qui se posaient des questions. J’étais très pote aussi avec Ben Mabrouk, qui avait connu le Paris FC avant le Racing, j’adorais Alim, sa fidélité. Quand tu as l’âge des joueurs, c’est très drôle. Après, ça l’est moins.

Quand on est jeune et qu’on arrive comme ça dans le monde du journalisme sportif, on est intégré facilement par ses pairs ?
Quand j’arrive dans le milieu, je me dis : « Quel vieux monde ! » Faut se faire sa place, tu cherches ta place. T’as les mecs qui ont vécu les aventures de Saint-Étienne, de la première bande à Hidalgo en équipe de France… Oh là là là là là là. Je suis très déçu par Larqué, alors que pour moi, Larqué, c’était Saint-Étienne, la reprise de volée contre Lens, quand j’étais petit. Un mec comme Jacques Vendroux, on s’entendait pas du tout quand je débarque, j’étais tellement pas de sa bande, sa culture. On a failli se battre. Et puis après, on avait des amis communs, et tu sais comment il est, Jacques, il est clanique, les amis de mes amis… Donc on est devenus copains. Vendroux, il a quand même organisé cette rencontre à Jéricho entre le Variété et une sélection palestinienne après les accords d’Oslo. J’y étais pour L’Événement du jeudi, en 1993. Je revois Platoche jouer aux cartes, dans les vestiaires.
Alain Giresse nous a raconté récemment combien c’est un souvenir qui l’a marqué.
Ah non, mais ce bordel, le terrain envahi… Les adversaires dont on sait que c’est parfois des mecs du Hamas qu’on vient de sortir de prison pour jouer au foot. Les Israéliens se sont intelligemment retirés de la ville. Il y a zéro sécurité, ou presque : disons que tu confies la sécurité de personnalités sur parole aux Palestiniens, aux milices du Fatah avec des armes clandestines qui viennent d’arriver… Et le Variétés a la grâce de perdre 1-0 !
J’ai vu plus d’homophobie à l’Assemblée nationale à l’époque du débat sur le mariage gay ou sur le PACS que dans toute ma carrière dans le football. Non, j’ai été con de quitter le foot.
Tu as déclaré à L’Équipe que tu as été con, d’avoir arrêté de couvrir le sport.
Oui, je l’ai regretté, après coup. Je ne parle pas des grands reportages ou des bouquins sur le Front nat’, Lionel Jospin, que j’étais heureux de faire… mais dans la quotidienneté, aller déjeuner avec des politiques, la nourriture trop riche, les mauvaises haleines, les écouter parler comme si c’était un art en soi, la politique… Putain ! Alors tu te fais inviter au stade, mais ça ne va pas ! Si t’es pas là comme journaliste sportif, ta place, tu dois la payer, quoi. J’ai fait des trucs sympas, je crache pas dans la soupe, mais si j’avais continué dans le sport, j’aurais pu avoir une tout autre vie, être un tout autre mec, heureux d’une tout autre manière, me sentir appartenir à une famille. Quand je revois Patrick Urbini ou Erik Bielderman, je suis tellement heureux. Je n’ai pas cette joie-là quand je recroise des mecs qui bossent en politique, il n’y a rien, quoi. Sans doute parce que c’est la jeunesse que j’ai quittée. Mais enfin, quand tu vois ce que la politique est devenue… Bielderman, qui est devenu le confident de Ferguson, c’est merveilleux. C’est mieux d’être le confident de Ferguson ou celui de Sarkozy ou d’Eric Ciotti, entre nous ?
Bah t’as pas mal de journalistes sportifs qui ont de la bouteille qui ont mal à leur football, aussi…
Oui, mais si tu veux, j’ai entendu beaucoup plus de saletés, de choses ignobles dans les milieux politiques que dans le foot, beaucoup plus de perversions, de choses malsaines. Tu entends ce qu’ils disent les politiques, sur les musulmans ? Tu n’entends pas ça dans le foot. Alors oui, il y a toujours un connard qui pense que sa religion lui demande de ne pas arborer le brassard arc-en-ciel. Mais j’ai vu plus d’homophobie à l’Assemblée nationale à l’époque du débat sur le mariage gay ou sur le PACS que dans toute ma carrière dans le football. Non, j’ai été con de quitter le foot. J’y ai vu tellement de belles choses que je n’ai pas vues en politique. Si j’avais pu ne parler que de ça…
Et tu fais toujours des complexes sur le jeu, la tactique ?
J’ai progressé. Le jour où j’ai compris que les équipes que j’aimais bien, comme le Barça ou les Pays-Bas, jouaient la possession un peu comme des handballeurs autour de la zone, en attendant de percer, ça a été une illumination. Tu monopolises le ballon, tu tournes autour, tu cherches la faille. Luis Enrique dit que le premier boulot de l’attaquant, c’est de défendre, alors que Rinus Michels disait que le premier boulot du défenseur, c’est d’attaquer, donc ça se rejoint un peu, non ? Moi, je trouve plus intéressant Luis Enrique que n’importe quel politique, cette folie qui l’habite. Brian Wilson vient de mourir, eh bien je vois bien Enrique chez lui devant un tableau noir et une pelouse dans son salon qui essaie d’inventer un jeu qu’on n’a jamais inventé avant lui. Artur Jorge, il était habité. Bielsa, il est habité. Dis-moi qui c’est, le Bielsa de la politique ?
Monaco : des sénateurs en PrincipautéPropos recueillis par Vincent Riou, à Paris // Photos : Renaud Bouchez pour So Foot