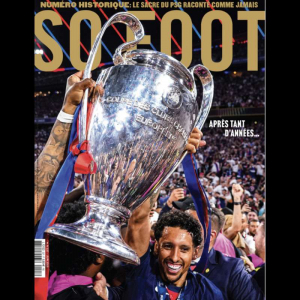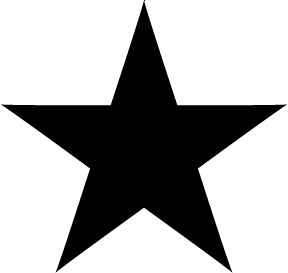- CDF
- Sochaux-Nancy
- Interview
- Pablo Correa
« Au départ, ma femme et moi voulions juste pouvoir acheter un taxi… »

Arrivé en France à 28 ans, Pablo Correa est devenu progressivement une figure du football français. Le tout avec un accent unique, quelques trophées, mais surtout l'amour d'un club, Nancy, et de son président. Rencontre avec un gamin de Montevideo.
Vous êtes un enfant de Montevideo. À quoi ressemblait l’enfance de Pablo Correa ?Je viens d’une famille de classe moyenne avec une sœur et un frère. Je suis l’enfant du milieu, celui qui est censé faire sa place. Mon enfance a été plutôt heureuse, je pourrais même dire jouissive parce que je jouais beaucoup. J’avais une belle bande de copains, on était tous du même quartier, on allait tous à la même école. Ma famille habitait dans un bâtiment où il y avait beaucoup d’enfants, beaucoup de vie.
À partir de quel moment le football est entré dans votre vie ?J’ai commencé le foot très tôt, vers sept-huit ans, toujours pour suivre un de mes copains qui était un bon joueur de football, mais qui n’a pas réussi à percer. À l’époque, le ballon comme le vélo, c’était le jouet par excellence. Je me souviens que lorsque j’étais jeune, dès qu’on me demandait ce que je voulais comme cadeau, je répondais un ballon. C’était une obligation. Le ballon était présent en grande partie dans mes journées. Il faut savoir qu’en Uruguay, l’élève a le choix : soit il va à l’école l’après-midi, soit il y va le matin, et ça, de l’école primaire au lycée. Il n’y a pas assez d’écoles par rapport au nombre d’élèves. Moi, par exemple, j’étais toujours du matin, donc mon après-midi était libre pour les devoirs d’abord, mais aussi pour les activités physiques. J’allais dans un club privé où on pouvait nager, courir, etc. Les études, c’était par obligation, mais pas forcément par volonté. Je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard.
Montevideo est une ville de foot par excellence avec le Club Nacional et Peñarol… Oui, après les études, je suis entré dans le système de formation au Nacional. Le club est à Montevideo, donc ça me permettait de garder mon cocon familial, contrairement aux gamins de province. Je m’entraînais et après, je rentrais dormir chez moi. Le football n’était pas un hobby, mais plutôt un loisir. Quand j’ai commencé ma formation, mon seul rêve était de jouer un jour dans ces grands stades, pas forcément de devenir footballeur professionnel.
Chez les Correa, on était plus Nacional ou Peñarol ?Ma mère était supportrice du Nacional, mais bon, elle n’était pas réellement intéressée par le football avant que je joue. Tout le reste de la famille était plutôt Peñarol.
Pourquoi avoir signé au Nacional alors ?Quand tu es gamin, tu as toujours cette période qu’on appelle le baby foot, quand tu as onze ans. Je suis tombé dans le système des centres de formation un peu par hasard avec un entraîneur qui m’a voulu très tôt. Je ne faisais pas partie de ces personnes qui disent « non, moi je suis de Peñarol, je ne peux pas jouer pour le Nacional » . Moi, j’ai porté les couleurs du Nacional pendant des années, mais à la fin de ma formation, le club n’a pas cru en moi et je me suis retrouvé sans rien. Ça a été une sorte de défi pour moi, je suis parti jouer en deuxième division et les choses se sont ensuite accélérées.
Vous faites ensuite plusieurs clubs en Uruguay, mais aussi un passage en Argentine. Et un jour, Gérard Parentin et Jacques Rousselot, les deux dirigeants de Nancy, effectuent une tournée en Uruguay avec l’entraîneur László Bölöni. Comment ça se passe concrètement ?Quand ils sont venus, j’étais suspendu. J’avais célébré un but devant les supporters adverses et ça n’était pas trop passé en Uruguay. Ils arrivent après avoir repris contact avec l’ancien défenseur de Nancy, Carlos Curbelo, mais aussi pour approcher des joueurs pas chers, car le club était dans une situation économique compliquée. Au départ, les dirigeants viennent juste jeter un œil, ils n’avaient pas un joueur en particulier dans le viseur. Carlos leur avait alors expliqué qu’il avait vu un joueur intéressant, qu’il était suspendu, mais qu’il y avait possibilité d’organiser un match amical. Pendant le match, on gagne 1-0 et je marque de la tête. Moi, quand ils sont venus, pour tout vous dire, je ne savais même pas où était Nancy. En France d’accord, mais je ne savais pas à quel endroit. Dans ma tête, ça aurait pu être aussi bien dans le Sud qu’en Bretagne. J’étais allé regarder dans l’atlas de la bibliothèque familiale. Jusqu’ici, rester en Uruguay était un choix pour ma famille. Mais bon la France, c’était la France, donc j’ai tout de suite eu envie de venir.
La France, c’est aussi du foot. C’était aussi Platini. C’était un nom qui vous parlait à l’époque ?Oui, forcément. Il y avait eu la Coupe du monde 78 en Argentine, cette main de Marius Trésor qui a été vécue pour nous comme une injustice énorme. La France était très connue en Uruguay. Les clubs, on ne les connaissait que très peu. On entendait parler vaguement de Saint-Étienne, Monaco, mais c’est tout. Le championnat français n’était pas diffusé chez nous, c’était surtout le championnat espagnol, italien ou allemand. L’équipe nationale était plus populaire, car il y avait déjà les Panini. Cette génération, on l’a revue en 82.
Est-ce que vous vous rappelez de votre première rencontre avec le président Rousselot ?Oui, en fait, elle n’a pas eu lieu en Uruguay. En 1995, il avait dû repartir, car son meilleur ami était sur le point de mourir. Je ne l’ai su que plus tard, au restaurant avec Curbelo, Bölöni et le président Parentin. À chaque fois qu’on parle de leur voyage, c’est surtout ce souvenir qui revient. Monsieur Rousselot, je ne l’ai connu qu’en arrivant à Nancy.
Quelle est la première réaction quand vous débarquez à Nancy ?En fait, j’ai surtout été étonné par le centre d’entraînement. Je l’ai trouvé un peu vieillot, pas dans un sale état, mais on sentait qu’il y avait un manque de moyens. C’était beaucoup moins professionnel que ce à quoi il ressemble aujourd’hui. Après, la ville, j’avais bien aimé. Au niveau du foot, il y avait forcément un décalage par rapport avec ce que j’avais connu en Uruguay. C’est normal. À la base, le président Rousselot voulait recruter deux Uruguayens. Finalement, je suis arrivé tout seul et dans le vestiaire, il n’y avait que Jean-Claude Fernandes qui parlait espagnol. C’est lui qui m’a guidé, mais la barrière de la langue est très difficile, elle vous laisse isolé. Ce n’est pas le jeu en lui-même qui m’a choqué.
Qu’est-ce qui vous a choqué ?Un jour, après une préparation très lourde avec László Bölöni, où je crois que je n’avais jamais autant couru de ma vie, le coach nous a convoqués pour le premier match. Et là, je suis tombé sur le cul. Le coach est entré dans le vestiaire et a donné une liste de joueurs convoqués pour le match du lendemain. Dans cette liste, il n’y avait que 14 noms. Je me dis qu’il manque du monde. Je vais voir Jean-Claude Fernandes et je lui demande pourquoi il manque des joueurs. Il me dit que c’est comme ça, qu’on part à 14. Il n’y avait que trois remplaçants. Pour rigoler, Jean-Claude m’a dit que si le gardien se blessait, c’est moi qui serait obligé de le remplacer. Dans un monde professionnel, pour moi, c’était impensable alors que même quand mon père jouait, on était déjà au moins seize dans un groupe. À ce niveau-là, c’est quelque chose qui laissait transpirer beaucoup d’amateurisme.
Bölöni était réputé pour être un entraîneur très dur. Qu’avez-vous appris de lui ?Il faut remettre les choses dans leur contexte. C’était sa première expérience professionnelle à une époque où les staffs étaient plus réduits. L’entraîneur devait alors s’occuper de beaucoup de choses. Il faut aussi se mettre à sa place et comprendre qui il était en tant que joueur. Je pense que lorsqu’on devient entraîneur, on a tendance à vouloir améliorer des choses sur lesquelles on n’était pas d’accord étant joueur. László était très exigeant, mais il était capable de nous faire travailler énormément au niveau mental. C’est une question de culture et d’éducation.
En quoi votre culture uruguayenne vous sert-elle dans votre métier d’entraîneur ?On évoque souvent en Uruguay la culture de la gagne. Je pense que cette notion existe aussi en France. La seule différence, probablement c’est que dans mon pays on est soumis à la compétition plus rapidement et plus souvent. En tout, il faut être le meilleur. C’est une question de pragmatisme. En Uruguay, on cherche avant tout le résultat, à n’importe quel prix. Je pense que ça vient du fait qu’on est un tout petit pays et qu’il nous faut exister entre l’Argentine et le Brésil.
Vous avez pris votre retraite en 2000. À quel moment avez-vous décidé d’être coach ?Un an avant la fin de mon contrat avec le club, au moment de faire la photo officielle, je vais voir le président et je lui explique que physiquement je suis déjà bien entamé, que j’ai moins envie… Je ne voulais pas être un escroc, je ne voulais pas jouer avec les gens et encore moins avec l’entraîneur de l’époque, Francis Smerecki. Si mentalement on décroche, je ne pense pas que l’on peut être performant sur le terrain. On avait déjà évoqué la possibilité d’une reconversion avec le président. Je pense qu’il avait une idée derrière la tête, donc j’ai commencé à passer mes premiers diplômes. J’ai aussi beaucoup appris auprès des catégories de jeunes et ensuite comme observateur pour Francis. C’est à ce moment précis où j’ai commencé à regarder le football comme un technicien, comme un observateur, plutôt que comme un spectateur.
Aviez-vous un idéal tactique ?Je pense que tactiquement, j’ai beaucoup plus appris en Uruguay qu’en France. Avec László, on travaillait surtout sur l’impact physique par exemple. En Uruguay, j’ai eu des entraîneurs qui m’ont enseigné beaucoup de choses, car j’étais un joueur curieux.
Pendant toute votre première période sur le banc à Nancy, vous avez souvent été critiqué pour votre style ultra défensif. Ce choix de jeu était-il une volonté ?C’était plutôt une nécessité en fait. Cette manière de jouer nous a fait monter en Ligue 1. L’objectif de Nancy était de monter rapidement et de rester au moins cinq ans. Moi, je n’avais pas de plan, une fois que j’étais monté, je pouvais y rester à vie. La génération que j’ai eue a quand même réussi à remporter une Coupe de la Ligue, à terminer une fois quatrième du championnat, à disputer la Coupe d’Europe. À l’époque, jouer aussi défensif était un objectif pour stabiliser le club. C’était au détriment d’un football champagne oui, mais il fallait qu’on soit efficace avant tout. On s’est construit à partir de là parce qu’au niveau des résultats, ça marchait. On a évolué par la suite. Je n’ai jamais trop écouté les critiques des observateurs, mais un jour, après une victoire à Nancy, les supporters ont sifflé, car le jeu que l’on proposait ne leur convenait pas. J’ai découvert une forme de bourgeoisie du public, des supporters qui pensaient qu’on pouvait gagner tous nos matchs avec la manière. Quand vous arrivez de Ligue 2, avec un budget serré, on fait avec ses armes. Quand on bat Bordeaux, qui a quarante ans de Ligue 1, c’est un exploit. Pas autre chose. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Vous savez, quand je suis parti de Nancy, mon équipe était, selon les statistiques, cinquième du championnat au nombre de tirs.
Est-ce que ça vous a gêné à un moment donné qu’on vous dise que Pablo Correa n’était pas un coach spectaculaire ?Franchement, non. Ce qui me gênait, c’est quand les anciens supporters de Nancy disaient ça. Vous savez, avant que j’arrive au club, l’ASNL n’avait joué l’Europe qu’une seule fois, à l’époque de Platini. Qu’on vienne me dire tout ça alors qu’on avait une des meilleures générations du club, ça m’a déçu pour mes joueurs. Est-ce que les supporters se rendaient compte qu’ils étaient face à la meilleure génération de Nancy en matière de résultats ?
Dix ans à la tête d’un même club, est-ce que c’est long ?C’est très long. En 2011, personne n’a compris pourquoi je suis parti du club. La réponse, elle est là en fait. À un moment, tu ne peux plus, tout te dépasse. C’est la même sensation qu’au moment où j’ai arrêté ma carrière. Je ne voulais pas être un escroc. Quand tu n’estimes pas être à 100%, tu ne peux pas demander à tes joueurs de l’être. C’est une question d’éthique. Il y a eu une usure à un moment et c’est normal. Il n’y a eu aucun conflit. Je ne voulais simplement pas voir ce que ça aurait pu donner si j’étais resté. Je ne voulais pas exploser mon physique car je ne connaissais pas mes limites. Je ne voulais pas qu’on me retrouve un jour, par terre, la gueule de travers. J’ai eu une discussion avec ma femme et on était d’accord, il fallait faire un break.
Est-ce que c’est cette usure qui vous a poussé à aller voir ailleurs, à Évian ?Non, je voulais vraiment tout couper. Je n’avais aucune envie d’aller voir ailleurs. Évian, ça a été une opportunité. Ils sont venus me voir pour prendre la suite de Casoni en juin. Là-bas, la situation s’est dégradée et on m’a demandé si j’étais prêt. En pensant que ces six mois étaient suffisants, je me suis dit pourquoi pas. Mais je me suis rendu compte plus tard que je n’étais pas prêt. Surtout que la situation que l’on m’avait présentée était complètement différente de celle que j’ai trouvée. Je n’avais pas les batteries pour lutter, c’est dommage. On a terminé neuvième de Ligue 1, mais ça n’a servi à rien.
On vous sent déçu de cette expérience à Évian…Si j’avais su avant ce que j’allais trouver, je n’y serais jamais allé. C’est sûr. Quand je suis parti d’Évian, ma femme m’a dit que cette expérience me servirait. Oui, j’ai connu des personnes sympas, mais j’en ai connu d’autres… Je suis quelqu’un de cash. Ce que j’aime, c’est lorsqu’on me présente une situation telle qu’elle est. Cette personne qui m’a contacté pour Évian ne m’a pas présenté la situation comme je l’ai trouvée à mon arrivée.
Qu’est-ce qu’il s’est passé dans ce restaurant avec monsieur Rousselot en janvier 2013 ? (le jour où le Président lui a demandé de revenir, ndlr)
Avec le président, ça se passe toujours dans un restaurant. C’est le seul moment qu’il a de libre pour discuter. C’était pas un rendez-vous de travail. Dans ces moments-là, on peut parler de tout, des choses de la vie, de politique, de football…
Comment pourrez-vous décrire votre relation avec le président ?C’est mieux que mon père dans la relation. J’ai la retenue par rapport à la hiérarchie, mais il y a aussi ce côté ami. Avec mon père, je ne peux pas parler des mêmes choses. Là, oui, c’est mieux qu’un père, car il a tout pour être un père, mais aussi pour être un ami. On peut parler de tout, notamment de choses dont on ne peut pas parler avec son père à cause de la pudeur.
Cette pudeur, ne l’avez-vous pas perdu ce soir de 2006 quand vous avez remporté la Coupe de la Ligue ? (il paraît que la fête a été mémorable, ndlr)
Oui, celle-ci, elle était bonne (rires). Il faut. On a fêté beaucoup de choses dans cette période, mais ce qui est dommage, c’est de toujours penser au lendemain. Je regrette de ne pas avoir assez fêté certaines choses. On s’arrête plus sur les mauvais moments que sur les bons.
Aujourd’hui, Nancy connaît une situation économique particulière. Le président Rousselot a été obligé cet été de réduire le budget, de licencier des personnes. Comment vit-on ces choix quand on est un homme du club ?Lui voit l’humain avant le professionnel. Le président Rousselot s’est toujours démerdé pour que Nancy ne connaisse pas ce genre de situations. C’est toujours difficile à vivre. Moi, quoi qu’il en soit, je me sens toujours redevable du président. Faire mon travail convenablement ne me donne aucun droit pour demander certaines choses. Au début de cette année, il m’a demandé de faire un effort, je l’ai fait. Ça reste entre nous, je ne vous dirai pas combien. C’est le genre de choses qui me donne de l’énergie, pour aller chercher la Ligue 1, pour le club, mais aussi, et surtout, pour le président.
Cette saison, Nancy marque des buts, n’en prend pas beaucoup et joue vraiment au foot. Qu’est-ce qui a changé entre le Pablo Correa d’avant et celui de maintenant ?Quand vous prenez du recul à un moment, tout paraît différent. La période où on est en poste, on est dans une sorte de lessiveuse. De temps en temps, vous ouvrez la porte pour respirer, mais c’est tout. En retraite, j’ai pu regarder du foot, progresser sur beaucoup de choses et j’ai compris ce que je voulais vraiment. Avant 2011, je n’ai pas eu le temps de vraiment façonner mes idées. Maintenant, oui, car le groupe est aussi différent. Les dirigeants de foot pensent souvent que quand un entraîneur veut s’arrêter, c’est sans raison. C’est faux, c’est surtout pour devenir un homme neuf.
Avec du recul, si vous n’aviez pas été entraîneur, qu’auriez-vous fait de votre vie ?Au départ, avant d’arriver en France, l’idée avec ma femme était de pouvoir acheter un taxi. Un taxi, ça permet de travailler, de se former, etc. C’est une question de voir le monde du travail, mais après je n’ai pas eu le temps de me poser la question. Entraîner a toujours été une évidence. Mais j’aurais certainement été commerçant. Un travail digne qui permet de maintenir ma famille me suffit largement.
Votre famille semble très importante dans votre vie. Comment supporte-t-on Pablo Correa au quotidien ?Il faut demander, mais je suis très calme malgré l’image que je peux dégager. Franchement, je suis un déconneur dans la vie. Quand on est entraîneur, on manque de temps pour l’éducation et je remercie ma femme pour tout ce qu’elle a apporté à nos enfants. Moi, je suis pas un chien, je suis juste un peu maniaque, j’aime l’ordre et je suis même un peu casse-couilles là-dessus. Après, à la maison, c’est surtout moi qui me fais bouger.
Dunkerque perd gros malgré un bijou, belle opération pour ClermontPropos recueillis par Maxime Brigand