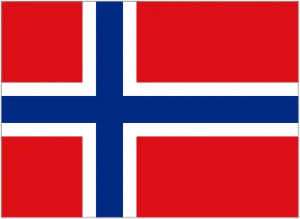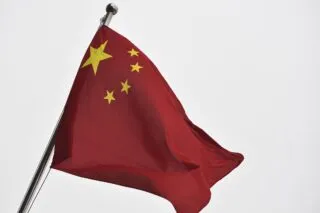Mon voisin est de Boca

Quand on débarque au milieu de ce grand bordel qu'est Buenos Aires, sans parler un seul mot d'espagnol, le football peut parfois vous sauver la vie et vous garantir une socialisation minimum. Car en Argentine le football se partage. Le pizzaïolo du coin de la rue, le vendeur de légumes d'en face ou le type qui est assis à côté de vous en classe. Et puis, le vocabulaire footballistique est international, Zidane signifie magique dans toutes les langues et Maradona Dieu, non ? Petites histoires d'une grande passion.
Regarder un match en streaming en Argentine peut s’avérer frustrant. Très frustrant. A la fois du fait du léger décalage avec le direct télévisé et de l’épaisseur des murs. Explications.
Mercredi 4 Juin, Boca se déplaçait au Maracana pour la demi-finale retour de la Libertadores après un match nul préoccupant à domicile. Boca n’a pas perdu chez les Cariocas depuis 14 ans tandis que le Santos de Pelé est la dernière équipe brésilienne à les avoir sortis de la Libertadores…De l’enjeu, de la pression, ambiance des grands soirs.
Domination stérile des Xeneizes, 0-0 à la mi-temps. Et puis, à la 60ème minute, alors que les Brésiliens tripotent innocemment la balle au milieu du terrain, un cri surgit au milieu de la nuit porteña. Au-dessus, à côté, au loin dans la rue, tout le quartier explose. Coup d’Etat contre Christina et pour le Soja ? Non, un « Goaaaaal » en dolby surround.
Qui a planté ce foutu but ? Mon barrio, à quelques dizaines de “cuadras” du Monumental est a priori plutôt de River. Les “Gallinas” seraient-elles en train de chanter la défaite de l’ennemi ?
Les Brésiliens se rapprochent de la cage de cette chèvre de Miglione, petites passes, la balle arrive dans les pieds de l’intenable Thiago Neves. Inquiétude. Et puis jaillissement de Paletta, relance rapide sur Datolo qui se lance dans un superbe show côté gauche. Dribbles chaloupés, centre parfait, tête de Palermo. Goal. Mon voisin est donc de Boca.
La fin du match se transforme inévitablement en écoute anxieuse des bruits de l’appart adjacent. A peine quelques minutes plus tard, alors que l’arbitre vient de siffler un coup franc dangereux pour les Brésiliens, un hurlement transperce les murs. Soit le voisin vient d’éventrer sa femme, soit Fluminense va en planter un.
Washington s’élance, je me cache les yeux, croise les doigts, croyant encore pouvoir changer le destin. Lucarne parfaite, la jolie voisine est encore vivante et descend toujours les escaliers de l’immeuble avec autant de grâce…
Le cri déchirant se répétera deux fois, Boca coule, la qualification s’envole. Aucun soulèvement collectif n’ayant agité le quartier, le dernier quart d’heure prend l’allure d’une longue agonie que l’on regarde avec l’espoir d’un condamné à mort, les mains liés et le bandeau sur les yeux.
A Buenos Aires, le football se partage. Un match se vit avec son voisin, son barrio, et parfois, au moins lors du Superclasico, avec la ville toute entière.
Le 4 mai dernier, installés à une table au milieu du trottoir devant l’impossibilité de trouver la moindre place dans tous les bars de la longue avenue Cabildo, à travers la vitrine, au-dessus de l’épaule du petit vieux et de la tête de son petit-fils, on peut distinguer les premières images du superclasico sur l’écran géant du bar.
Derrière nous, deux-trois passants s’arrêtent puis, peu à peu, d’autres désespérés qui ne veulent pas perdre le match de l’année. Après un quart d’heure de jeu, le trottoir s’est transformé en véritable tribune. Une hinchada mixte, des hommes, des femmes, des vieux, des gamins, des maillots bleus et jaunes, des rouges et blancs, des anonymes qui n’ont pas encore dévoilé leurs couleurs. Temporairement du moins, car au but de Battaglia, plus moyen de se planquer, la foule se partage entre cris de joie et soupirs de déception. Les klaxons retentissent, des gens s’embrassent, une petite vieille sortie promener son chien demande de sa voix chevrotante le nom du buteur. Certains festoient, d’autres rechignent, mais personne ne reste indifférent. Coup de sifflet de l’arbitre, remise en jeu, le match recommence et la tribune reprend son sérieux.
Aux alentours, l’instant d’un match, d’une heure et de quelques minutes, Buenos Aires l’effrénée s’est arrêtée, le temps s’est suspendu. Sur Cabildo, il n’y a jamais eu si peu de trafic, les bus, habituellement bondés, sont vides, Buenos Aires est une ville fantôme. Un conducteur égaré hurle en notre direction pour demander le score. « 1-0, cinq minutes à jouer » répond la foule. Klaxon de victoire. « Hijo de puta » réplique l’hincha de River debout derrière moi.
Dans notre tribune, quelques personnages ressortent. Il y a ce type qui écoute le match à la radio et qui s’impose comme commentateur officiel. Palacio, pour sa maladresse désespérante devant les cages, prend très cher. Roman est « une machine » . A droite, un petit grand-père en pantoufles qui suit le match attentivement. Plus loin, deux jeunes supportrices de River pas dégueulasses du tout. Parmi les spectateurs, certains s’échangent des coups d’œil, des solidarités naissent, des opinions se partagent. Le match a aussi lieu sur le trottoir qui, l’espace de 90 minutes, ressemble à une réunion d’une bande de potes qui se boivent quelques Quilmes, la bière nationale, devant le superclasico.
Même si ce soir il y aura des vainqueurs et des vaincus, des heureux et des malheureux, tout le monde s’est rassemblé pour voir ce mach. Des familles coupées en deux entre Boca et River sont venues le voir ensemble. J’en deviendrais un peu niais mais mince, parfois, c’est quand même beau le football.
En poussant un peu le vice, on pourrait même lui attribuer quelques valeurs éducatives. Souvent, en choisissant ses cours à la fac en début de semestre, on fait de grosses conneries. On prend un cours sur le péronisme en pensant pouvoir un jour y comprendre quelque chose. On en choisit un autre le mercredi soir de 19h à 23h en oubliant que le mercredi, c’est le jour de la Libertadores. L’erreur bête. De celles qui vous font manquer le quart de finale retour entre l’Atlas de Mexico et Boca Juniors.
Une nouvelle fois, les Xeneizes ont merdé à l’aller, 2-2, et se retrouvent en difficulté. La UBA, université de Buenos Aires, est supposée être une des meilleures facs d’Amérique du Sud mais ses locaux ont plutôt l’air d’un squat ou d’un hangar désaffecté.
Aux murs, des affiches politiques partout, un marteau et une faucille par ci, la tête du Che ou de Rodolfo Walsh (1) par là. Une fenêtre sur deux est pétée et comme il n’y pas assez d’argent pour payer le gaz cette année, malgré les manteaux et les matés, ces cours de “culture populaire argentine” dans le froid des nuits d’hiver sont longs, très longs.
Mais du coup, le « Gooaaal carajoooo » hurlé dans la rue résonne bien distinctement dans l’amphi. La prof s’arrête et demande qui joue. Boca – Atlas répondent les 200 étudiants. Quelques minutes plus tard, seconde clameur dans la rue. Dans la classe, une bonne trentaine de personnes craque, prend ses affaires et s’enfuit en courant vers le bar le plus proche pour suivre la fin du match. Ceux qui sont restés tripotent leurs portables, le cours est rythmé par les bip-bip des messages qui actualisent l’évolution du score. Au troisième but – une petite merveille de lob de Palermo – cette fois la moitié de l’amphi se barre et se retrouve devant le café du croisement de Corrientes et Rio de Janeiro.
Au fond, ce fut peut-être le plus bel exemple d’une culture populaire argentine que Diego Lucero, journaliste et écrivain uruguayen expatrié à Buenos Aires, décrivait ainsi : « C’est un peuple qui veut être heureux. Et qui, chaque dimanche, l’est, car il se réveille avec les cris et s’endort avec la musique du toucher de balle, résonance sonore de l’émotion sans pareille du football, qui est pour le peuple passion, folie, pulsion, emportement, colère, pleurs, rire, fête » (2).
Par Pierre Boisson, à Buenos Aires
1 – Journaliste et écrivain argentin, auteur de “Opération massacre”, Walsh se définissait cependant avant tout comme un combattant participant à la lutte contre la dictature aux côtés des organisations armées d’extrême gauche, notamment des “Montoneros”. Le 25 mars 1977, Rodolfo Walsh devient l’un des 30 000 “desparecidos”, victime de la dictature.
2 – Diego Lucero, « Hoy comienza el campeonato y habrá fiesta para rato » dans “Siendo ruido de pelota”.
Par