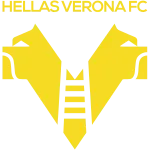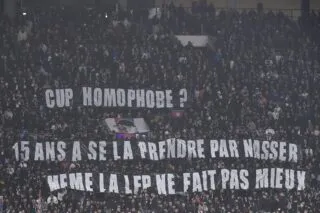Turquie : Le nouveau monde

Depuis dix ans, sans avoir l'air d'y toucher, la Turquie s'est imposée comme une nation incontournable de l'espace «football». Une success story enclenchée au début des années 90 qui bouscule aujourd'hui le paysage footballistique européen, réputé pour être l'un des plus exclusifs lorsqu'il s'agit de répartir les pouvoirs. Rafraîchissant.
« L’homme malade de l’Europe » est sur la voie de la guérison. Le sobriquet, qui collait à la peau de la Turquie depuis le XIXème siècle, du fait de l’effondrement de son empire, n’est plus d’actualité. Et si sa qualification pour les quarts de finale de l’Euro est le meilleur témoignage d’une vigueur retrouvée, la Turquie n’a pas attendu cet improbable exploit pour se refaire une santé.
D’un point de vue géopolitique, la Turquie a toujours attisé les convoitises. Presque logique pour un pays qui fait la jonction entre l’Europe et l’Asie. Un trait d’union hautement stratégique où les plus grandes puissances mondiales (Angleterre, France, Russie et USA) s’y sont régalé la chique, avec comme enjeu principal, le contrôle des détroits du Bosphore et des Dardanelles. Et en même temps que leurs sous-marins, les Britons profitent de l’occase pour y introduire le cuir. Et ça marche. Besiktas (1903), Galatasaray (1905) et Fenerbahçe (1907) voient le jour, et cela malgré les réticences du sultanat, qui voit d’un mauvais œil l’introduction d’un sport aux origines non turques dans un pays déjà soumis à une forte ingérence politique.
Conséquence immédiate, le régime en place freine des quatre fers pour éviter que la sphère ne se répande trop vite dans la contrée. Du coup, le football turc se recroqueville sur lui-même et peine à se développer. L’arrivée au pouvoir de Mustapha Kemal, qui fonde la République turque en 1923, l’année de la création de la fédération turque de football, va bouleverser son l’évolution. Jusque-là ultra-conservateur, il profite de la politique générale du “père des Turcs” pour se débrider quelque peu et s’ouvrir enfin.
Avec la mise en place d’un championnat professionnel en 1958, de nombreux entraîneurs “étrangers”, de seconde zone pour la plupart, déboulent alors. Sans succès. Le mouvement n’en reste pas moins enclenché. Et c’est Galatasaray, qui s’est toujours considéré comme étant une « fenêtre sur l’occident » , qui lance la seconde vague, au début des années 90, avec, cette fois-ci, l’arrivée de techniciens de renom comme Jupp Derwall, « l’homme qui a ouvert une nouvelle ère dans le football turc » dixit la presse spécialisée, Tomislav Ivic, Graeme Souness, Mircea Lucescu mais aussi Éric Gerets, qui vont véritablement le faire décoller.
Besiktas et Fenerbahçe ne tardent pas à suivre avec Toshack, Scala, Daum, Del Bosque et Tigana pour les premiers ; Hiddink, Parreira, Low, Zeman et Zico pour les seconds. En matière de coachs, difficile de faire mieux.
Et au niveau des joueurs c’est un peu la même. L’arrêt Bosman, qui coïncide avec l’arrivée de quelques-unes des plus grandes fortunes du pays à la tête des clubs, comme Aziz Yildrim à Fenerbahçe, booste inévitablement son football. Les clubs embauchent alors quelques cadors comme Hagi, Jardel, Van Hooijdonk, Taffarel, Popescu, Ortega, Okocha, Anelka, Kezman ou Roberto Carlos. Ce dernier, preuve de la nouvelle attractivité de la Turquie, émane à plus de 4 millions d’euros par an, nets d’impôt.
Autre donnée importante, le footballeur turc a du mal à s’expatrier, ce qui permet à ses clubs de conserver les forces vives du cru. Un coup double inespéré. Et là encore, ça fonctionne. Galatasaray – fort de son ossature romano-turco-brésilienne – remporte la Coupe de l’UEFA en 2000 et relègue les Souliers d’Or de Tanju Colak au rang de vieux souvenirs poussiéreux.
Une première victoire qui décomplexe le football turc et le pousse à rentrer dans la logique économique du football européen. Désormais, afin d’atteindre le niveau international, ses clubs devront recruter à “l’extérieur”. Une politique qui ne semble pas effrayer les dirigeants turcs, à l’image de Murat Ozaydinli, membre du comité directeur de Fenerbahçe : « Notre club va continuer à recruter des stars étrangères parce qu’il est devenu aussi attractif que le Milan AC, Barcelone ou le Real Madrid » .
Et c’est notamment vers l’Amérique du Sud et tout particulièrement vers le Brésil, qu’ils vont se tourner. De manière frénétique. Istanbul devient alors une sorte de petit Copa Cabana. Mais là où ils pouvaient être estampillés comme de simple mercenaires, les Alex, Bobo, et autre Eder, deviennent de véritables icônes qui se fondent parfaitement dans leur nouvel environnement. Preuve d’une adaptation réussie, Aurelio, Brésilien de naissance, devient international turc, sous le nom de Mehmet Aurelio. Une parfaite symbiose qui en dit long sur l’évolution des mentalités dans un pays aussi conservateur que la Turquie.
Toujours est-il que les résultats sont là. En 2008, avec la même recette que le Galatasaray 2000, c’est-à-dire une équipe à fort accent brésilien (Alex, Edu, Deivid, Aurelio, Roberto Carlos), le Fenerbahçe atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Et dans une Ligue des Champions hautement sécurisée, c’est un exploit. Mais le meilleur baromètre de la bonne santé du football turc reste sa sélection, 3éme du Mondial 2002, deux ans seulement après avoir été quart de finaliste de l’Euro belge. Inimaginable il y a encore 10 ans.
Une métamorphose qui permet à ses meilleurs joueurs (Nihat, Tuncay, les frères Altintop) de bouger dans les meilleurs championnats européens, mais surtout, contrairement à la première vague (Sukur, Rustu, Alpay), de s’y imposer, prouvant que le Turc en cuissard n’est plus un intrus. C’est déjà ça de gagné. En attendant mieux.
Par Gauthier de Hoym
Corentin Tolisso raconté par les Lyonnais : « C’est un personnage incontournable de l’OL »Par