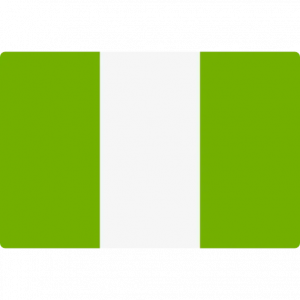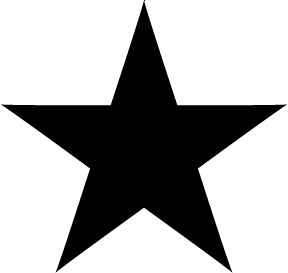Vous semblez défendre l’idée qu’un football socialiste, dans la foulée du onze hongrois, a existé, plus sur le terrain que dans la structure des clubs d’ailleurs. Qui en serait aujourd’hui le digne et le dernier représentant ?
Précisons d’abord que lorsque je parle de « football socialiste » – l’expression est de Gusztáv Sebes, l’entraîneur de la grande équipe hongroise des années cinquante -, je ne veux évidemment pas dire qu’il y aurait une manière spécifiquement « marxiste » ou « proudhonienne » de défendre, d’attaquer ou de tirer les corners ! Je me réfère, plus simplement, aux principes et aux valeurs qui fondent la philosophie de ce que je persiste à appeler le « beau jeu » . En ce sens, je me sens très proche de Bill Schankly – le légendaire entraîneur de Liverpool – lorsqu’il disait que le véritable socialisme, c’était « celui dans lequel hacun travaille pour tous les autres, et où la récompense finale est partagée équitablement entre tous. C’est ainsi que je vois le football et c’est ainsi que je vois la vie. » John Galbraith l’avait, du reste, parfaitement compris lorsqu’il affirmait, dans ses Chroniques d’un libéral impénitent, que le socialisme moderne était essentiellement né « d’un goût maladif pour les sports collectifs » . Or si le football est par essence un jeu collectif, on devrait pouvoir en tirer deux types de conséquence. D’une part – puisque c’est un jeu – qu’il doit trouver sa fin en lui-même, et non dans des conditions qui lui sont extérieures, comme par exemple le profit qu’en attendent investisseurs et sponsors (c’est ce primat des contraintes extérieures au jeu qui explique que la plupart des équipes – particulièrement en Ligue 1 – entrent aujourd’hui sur le terrain avec pour seul objectif de « ne pas perdre » ). Et, de l’autre – puisque ce jeu est collectif – que la passe, si possible vers l’avant, constitue le geste technique de base du football – celui qui conditionne tous les autres -, ce qui suppose évidemment que les joueurs jouent les uns pour les autres et non chacun pour soi (Jocelyn Gourvennec a récemment dit, dans L’Équipe, des choses remarquables sur la question). C’est la prise de conscience de cette réalité fondamentale qui avait rendu possible, vers la fin du XIXe siècle, le passage progressif du football britannique originel du dribbling game (jeu fondé sur le seul exploit individuel et privilégié par les clubs aristocratiques) au passing game (jeu adopté d’emblée par les premiers clubs ouvriers, notamment en Écosse). Et, pour répondre à votre question, c’est donc, bien entendu, le Barça de Pep Guardiola qui, en développant l’héritage de Johan Cruyff, a su ramener ce passing game sur les terrains de l’élite (900 passes en moyenne par match !). Alors que la plupart des théoriciens – il suffit de relire les textes des années 1970 – estimaient qu’un tel retour était désormais « utopique » (selon le mot d’Aimé Jacquet) à l’heure du football « moderne » . Naturellement, le Barça se trouve aujourd’hui confronté au même problème que les équipes qui pratiquaient le 4-2-4 hongrois et brésilien au moment où Helenio Herrera – pour briser leur jeu spectaculaire – avait mis au point son sinistre catenaccio. Comment faire face à des équipes qui ont désormais parfaitement décortiqué son système de jeu, tout en demeurant néanmoins fidèle aux principes philosophiques qui l’inspirent ? Le Bayern incarne, sans doute, l’une des solutions possibles. Mais il faut aussi savoir qu’avec un José Mourinho, le football « réaliste » – celui pour lequel seul le résultat compte – possède, à présent, un théoricien au moins aussi intelligent qu’Helenio Herrera.
Vous ne manifestez guère de sympathie pour les supporters et les ultras, ces derniers représentent pourtant une forme de culture populaire particulièrement méprisée par les élites et réprimée par les pouvoirs publics ?
Mais je suis moi-même un supporter de la Paillade depuis plus de trente ans ! Il est tout à fait normal, en effet, d’entretenir un rapport affectif privilégié avec l’équipe de sa ville, comme avec celle de son pays (ou celle de sa nation d’origine lorsqu’on est immigré). Et cela inclut – vous avez raison de le souligner – toutes ces formes de « religiosité » démonstrative – dont l’humour et la gouaille ne sont, du reste, jamais absents – qui sont effectivement la marque de toute véritable sociabilité populaire, à l’inverse de l’attitude généralement guindée des élites et des VIP (les romans de Nick Hornby et les films de Ken Loach ont su admirablement mettre en scène cette sociabilité populaire). Ce qui me dérange, en revanche, c’est lorsque l’aficionado – c’est-à-dire l’amateur du beau jeu – laisse entièrement la place au « supporter » et, a fortiori, à ce type particulier d’ « ultra » (tous les kops n’entrent évidemment pas dans cette catégorie) pour lequel le match n’est plus qu’un prétexte, parmi d’autres, à un fight quelconque (quitte à tourner le dos au match pendant l’essentiel de la partie). Il devrait aller de soi, au contraire, qu’un véritable supporter est forcément aussi un connaisseur averti du ballon rond. Il n’était d’ailleurs pas rare, dans mon enfance, que le public applaudisse un beau geste ou une belle combinaison, même lorsqu’ils étaient le fait de l’équipe adverse (en 1953, l’équipe de Hongrie était sortie sous les ovations du public de Wembley, émerveillé par le spectacle offensif qu’elle avait offert). Et l’on sait, du reste, qu’un véritable aficionado supporte également d’autres équipes que la sienne. La popularité internationale du Barça en est la preuve, tout comme celle du Brésil de Pelé autrefois. Ou du grand Reims d’Albert Batteux, de Fontaine et de Kopa.
Michel Platini défend le principe du fair-play financier, le foot pro ne sert-il finalement désormais qu’à nous faire croire en la possible moralisation du capitalisme ?
L’idée d’une « moralisation » du capitalisme est effectivement grotesque dans la mesure où ce système se veut, par définition, « axiologiquement neutre » (business is business). Et la mainmise croissante des intérêts financiers sur le monde du football – dont l’arrêt Bosman a constitué, en 1995, l’étape la plus décisive – ne peut évidemment conduire, à terme, qu’à dénaturer en profondeur l’essence de ce que les prolétaires britanniques appelaient jadis le People’s game. La corruption grandissante des ligues de football asiatiques et – avec le développement des paris en ligne – le nombre toujours plus grand de matchs truqués (je renvoie ici aux travaux de Declan Hill) en témoignent déjà suffisamment. Je mettrais cependant un bémol à vos propos. En s’attaquant au football, le système capitaliste a devant lui une organisation, certes déjà gangrenée depuis des décennies, mais qui possède toujours une certaine autonomie culturelle – du fait de la nature spécifique de ce sport – et donc un certain nombre d’obligations minimales envers le public populaire. De toute évidence, la FIFA et l’UEFA ont encore une logique de fonctionnement qui n’est pas exactement la même que celle de Goldman Sachs ou du FMI. On ne doit d’ailleurs pas oublier que l’arrêt Bosman (son équivalent au jeu d’échecs serait le droit pour les joueurs les plus fortunés de commencer la partie avec deux reines supplémentaires !) a été imposé à l’UEFA par la Cour de justice européenne au nom du principe libéral de la « libre circulation de la main-d’œuvre » . Sur la base de cette autonomie résiduelle, il est donc encore possible, théoriquement, non pas de « moraliser le capitalisme » – cela va de soi -, mais de rétablir un minimum d’équité sportive dans la gestion du football professionnel. Je n’ai donc aucune raison de suspecter a priori la sincérité de Michel Platini sur ce point. Autre chose, naturellement, est de savoir si la législation européenne le permettra, puisque sa fonction première, comme on le sait, est de rendre définitivement illégale toute contestation du libéralisme. Quoi qu’il en soit, la pyramide de Ponzi sur laquelle repose aujourd’hui ce sport (et notamment les revenus délirants qui tombent dans la poche de ses principales stars) ne pourra pas fonctionner indéfiniment. Le football professionnel pourrait connaître sa crise des subprimes beaucoup plus vite qu’on ne le croit.
Le beau jeu contre le verrou, n’est-ce pas oublier que c’est en défense que se mobilise le plus les valeurs de solidarité et de combativité ?
Ce n’est évidemment pas le fait de défendre que je conteste ! C’est le primat tactique du moment défensif, tel qu’il a été théorisé pour la première fois, dans les années trente, par Karl Rappan (on lui attribue également l’invention du libero), puis systématisé, dans les années soixante, par Helenio Herrera. Dans ce schéma supposé « réaliste » , une équipe ne doit plus entrer sur le terrain pour prendre le jeu à son compte et « faire le spectacle » (autrement dit, pour donner le meilleur d’elle-même). Elle doit, avant tout, être organisée pour ne prendre aucun but et ne miser que sur les contres et les coups de pied arrêtés – donc sur les seules erreurs de l’équipe adverse – pour se projeter vers l’avant et espérer marquer un but (certains matchs de José Mourinho sont, de ce point de vue, un véritable cas d’école). Si les deux équipes qui s’affrontent partagent cette philosophie du jeu – chacune attendant que l’autre prenne le jeu à son compte – il y a donc toutes les chances que le match qui en résulte soit particulièrement soporifique (il suffit de voir la Ligue 1). Dans le football « socialiste » , au contraire, les joueurs ont été formés (parfois dès le plus jeune âge, comme à la Masia – le centre de formation de Barcelone) à maîtriser le mouvement collectif vers l’avant – dont la passe et le « jeu en triangle » sont le ciment naturel – ainsi que l’art de déséquilibrer une défense dans les « zones de vérité » (c’est évidemment cette dernière phase de jeu qui exige le plus de créativité collective et le plus de prises de risque individuelles). Dans un tel système, les défenseurs participent donc de plein droit à la construction offensive, que ce soit par la qualité de leur relance (celle du gardien comprise) ou par ce soutien régulier qu’apportent les défenseurs latéraux aux attaquants, dont l’Ajax de Rinus Michels avait fait l’un de ses points forts. Ce n’est que lorsque le ballon est perdu que l’équipe toute entière doit alors basculer en mode défensif, à commencer par les attaquants, chargés de bloquer dès le départ la relance de l’adversaire en exerçant sur lui un pressing coordonné. Il ne s’agit donc pas d’opposer l’acte de défendre – qui exigerait, par lui-même, plus de « combativité » et de « solidarité » – à l’acte d’attaquer qui serait plus individualiste ou plus « artiste » (comme si Thiago Silva n’était pas aussi un artiste !). Avec, à la clé, l’idée sous-jacente selon laquelle les défenseurs devraient d’abord être choisis en fonction de leurs qualités physiques ( « les grands derrière, les petits devant » , disaient autrefois les éducateurs formés à l’école de Georges Boulogne). Dans un « football total » (le totaalvoetbal de Rinus Michels) chacun, au contraire, doit se sentir concerné à la fois par le moment offensif et par le moment défensif. Et ces qualités de solidarité et de combativité – portées par le plaisir de jouer ensemble et l’adhésion à la même philosophie du jeu – s’appliquent donc à tous les joueurs, quel que soit leur poste. Bien entendu, c’est là une manière de jouer que la domination croissante du football moderne par l’argent et les médias – et l’apparition corrélative de jeunes joueurs manipulés par leurs « agents » , ou par leur famille, et obsédés par la seule perspective de leur prochain contrat – favorise de moins en moins. C’est donc aussi en ce sens que j’ai pu parler d’un « football libéral » , miroir fidèle de la société où nous vivons.
Que ce soit le foot à 7 auto-arbitré en FSGT ou encore le futsal, les formes de pratiques du foot semblent vouloir s’émanciper des cadres classiques de la FFF plus que d’en prendre le pouvoir. Ne s’agit-il pas d’une jolie métaphore politique de la situation actuelle à gauche ?
À quoi il faut naturellement ajouter ces millions de jeunes (ou de moins jeunes) – filles ou garçons – qui continuent joyeusement à taper le ballon chaque dimanche en dehors de tout cadre officiel. Cette multiplication des structures parallèles ou indépendantes est assurément symptomatique. Elle témoigne d’une désaffection grandissante des amateurs de ce sport envers les méga-machines bureaucratisées du football officiel. Et, comme en politique – vous avez raison de faire cette comparaison – elle nous rappelle qu’il est toujours possible de soustraire une partie, plus ou moins grande, de notre vie quotidienne à la logique dissolvante du capitalisme, en se tenant, par exemple, délibérément à l’écart des modes et de l’information officielle, en créant des coopératives ou des circuits courts, en déconnectant régulièrement son ordinateur, ou même tout simplement en cultivant un potager, qu’il soit individuel ou collectif. Mais ce genre d’initiatives, aujourd’hui foisonnantes, a malheureusement ses limites. Il ne faut pas oublier, en effet, que le capitalisme est d’abord une gigantesque machine à détruire l’autonomie des communautés et des individus (la généralisation du salariat en est l’illustration la plus classique) et à récupérer à son seul profit tout ce qui subsiste ou naît en dehors d’elle. Que ces structures parallèles se développent au-delà d’un certain seuil et le risque sera donc grand de voir se reproduire à nouveau les mêmes mécanismes d’expropriation et de bureaucratisation. Sans compter que cela reviendrait à abandonner la pratique du football de haut niveau aux seules grandes organisations qui en ont officiellement la charge.
Est-ce que les mouvements contre le Mondial au Brésil ne sont pas l’un des nombreux signes d’un désenchantement envers le foot semblable à la fin du communisme avec la chute du Mur ?
Je ne crois pas qu’il y ait le moindre désenchantement des travailleurs brésiliens envers le football lui-même. Il suffit de suivre leur championnat national pour constater que leur passion quasi religieuse pour le fùtbol est demeurée intacte. En revanche, il est clair qu’ils ont désormais compris que les grandes cérémonies mondialisées – expositions universelles, Mondial de football, Jeux olympiques, etc – s’inscrivaient de plus en plus dans ce que Naomi Klein appelle la « stratégie du choc » (et cela explique notamment le choix des sites – par exemple celui du Qatar – qui ne correspond presque plus jamais à de véritables critères sportifs). Elles offrent effectivement une occasion privilégiée, pour les grandes firmes transnationales, d’implanter en un temps record dans un pays donné – et, en grande partie aux frais de l’État – les infrastructures qui sont les plus indispensables au développement du mode de vie capitaliste (grands complexes hôteliers, urbanisme « étalé » , nouveaux réseaux de communication ou de transport, etc). Tout en détruisant au passage, conformément aux leçons du capitalisme chinois, des pans entiers de l’héritage historique des différents peuples. À l’image, en somme, de ce qui se passe habituellement après un tremblement de terre ou le passage d’un ouragan dévastateur. On comprend, dès lors, que les travailleurs brésiliens, dont les conditions de vie sont souvent très dures, soient particulièrement exaspérés devant le gaspillage pharaonique que représentent les travaux du nouveau Mondial, alors que cet argent aurait pu être utilisé pour le bien commun. Ce qui prouve d’ailleurs – contrairement à la thèse défendue par les éternels critiques de l’ « idéologie sportive » (critique dont Christopher Lasch soulignait qu’elle relevait, sur le fond, du même combat que celui des vieux puritains anglo-saxons du XIXe siècle contre « l’alcool et les distractions populaires » ) – que l’on peut être à la fois un aficionado et un critique cohérent du système capitaliste.
De tous les partis politiques, le FN est celui qui aime le moins le foot. Trop d’immigrés, trop de musulmans ou juste trop populaire ?
Je suppose que vous faites ici allusion aux déclarations répétitives de Jean-Marie Le Pen sur le caractère trop « métissé » , à ses yeux, de l’équipe de France (déclarations qui ne sont, en somme, que la forme inversée de celles de l’idéologue libéral Daniel Cohn-Bendit). Ces sorties xénophobes sont évidemment d’autant plus stupides – mais le Front national n’est pas à une contradiction près – que le football (comme le sport en général) constitue justement l’un des lieux privilégiés où l’affirmative action ne joue à peu près aucun rôle. Un joueur d’origine africaine ou asiatique n’est jamais aligné, en effet, en raison de sa couleur de peau. Il est tout simplement aligné parce qu’il est le meilleur à son poste (sans quoi la gestion des clubs serait parfaitement absurde et contre-productive) ! Vous aurez d’ailleurs sans doute également remarqué que – contrairement à ce qui est devenu la norme dans l’univers des médias, de la grande entreprise ou du showbiz – il y a relativement peu de « fils de » dans l’univers du football. La raison en est simple (et elle devrait suffire, à elle seule, à confirmer la spécificité du sport). Il s’agit là, en effet, d’un de ces rares domaines où il est impossible d’intégrer l’élite lorsqu’on ne dispose d’aucun talent. Quant à savoir si les partis de gauche aiment ou non le football, je me contenterai de rappeler qu’ils ont presque tous défendu avec enthousiasme, en 1995, l’arrêt Bosman. Autrement dit, la décision suicidaire d’appliquer intégralement les principes du libre échange dans un domaine où régnait encore, pour des raisons évidentes de justice sportive, un minimum d’ « exception culturelle » . Et comme, par ailleurs, ces partis défendent – à juste titre – le principe de cette « exception culturelle » dans d’autres domaines – il est vrai plus élitistes -, j’en déduis logiquement que ce n’est certainement pas le souci du véritable People’s game qui les anime. Ce qui est, somme toute, assez cohérent avec leur fascination infantile pour les vertus du capitalisme.
À chaque fois la Coupe de France révèle son petit Poucet, symbole du foot d’en bas de la France profonde. Simple liturgie journalistique ou symptôme idéologique ?
Mais c’est justement ce qui prouve que le football est encore un sport populaire ! Le peuple a toujours vibré, en effet, pour les « petits » et les « perdants » – qu’il s’agisse de Mandrin, de Jacquou le croquant ou de Raymond Poulidor. Et sans cet antagonisme de principe – qui est tout sauf imaginaire – entre une « France d’en haut » et une « France d’en bas » , quel sens pourrait bien avoir – on se le demande – la Révolution française ou le projet socialiste ( « Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout ! » ) ? Ce qui constitue un véritable « symptôme idéologique » , c’est donc bien plutôt le fait que cette sympathie légitime pour les humbles, les obscurs et les sans-grade (faut-il rappeler, en 2014, qu’en écrivant Les Misérables, Hugo n’a pas écrit un roman « fasciste » ?), tout comme le regard forcément critique qu’elle implique à l’endroit de « ceux de la haute » – comme disaient les anarchistes de la Belle Époque – en viennent aujourd’hui à être dénoncés sur la scène médiatique et intellectuelle comme le signe irrécusable d’une inquiétante dérive « populiste » et d’un retour « aux jours les plus sombres de notre histoire » (chaque fois que j’entends cette expression stéréotypée, je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est à la Commune de Paris que songent en réalité les saltimbanques du monde médiatique). Et à ce train-là, on peut raisonnablement craindre l’apparition prochaine d’un saltimbanque encore plus éclairé que les autres qui viendrait tranquillement nous avertir que la véritable source de la « bête immonde » se trouve, depuis des siècles, dans le Roman de Renart ! Il est vrai qu’Ysengrin, avec sa bêtise un peu lourde et son sens aigu des privilèges, symbolise assez bien le monde des princes qui nous gouvernent. Y compris, par conséquent, ceux qui tiennent encore entre leurs mains le destin du football moderne.
À lire : Jean-Claude Michéa – Le plus beau but était une passe. Écrit sur le football (Climats)