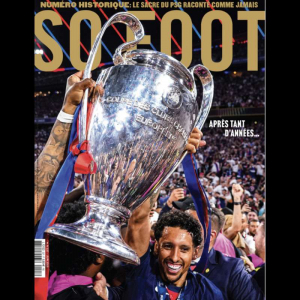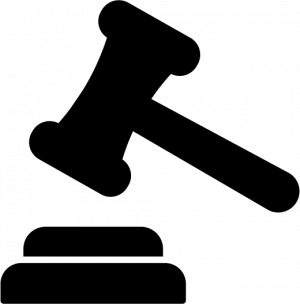- Autres championnats
- Suisse
Celestini : « J’ai passé dix ans de ma vie à tenter de ressortir les ballons propres »

Aujourd'hui entraîneur du Lausanne-Sport, Fabio Celestini, l'ancien joueur de Troyes et Marseille, raconte les entraîneurs qui l'ont marqué, pourquoi il faut jouer par l'arrière et ne jamais transiger, le détail tactique appris en Italie et son arrivée avortée à Saint-Étienne l'été dernier.
Dès votre première saison avec le Lausanne-Sport, vous êtes parvenu à faire remonter le club dans l’élite. Pour vous, l’enfant du pays, ça a dû être une sacrée fierté ?Exactement, je suis arrivé en mars 2015 en remplacement de Marco Simone pour essayer de sauver une équipe qui s’approchait très fortement de la relégation. C’est la saison suivante qu’on est remontés en Raiffeissen Super League, lors de ma première saison pleine. Avant d’être une fierté, ça a été un risque parce que Lausanne, c’est particulier pour moi. J’avais peur de devenir le Lausannois qui fait couler le club en seconde division, ça ne me faisait pas sourire. Finalement, on est parvenus à remonter et dans ma modeste carrière d’entraîneur, c’est un de mes plus beaux souvenirs.
À défaut d’être celui qui a fait couler le club, vous êtes donc le Lausannois qui l’a fait renaître. Comment ça se passe au quotidien ? On vous alpague dans la rue ?(Il sourit.) Non non, pas du tout. Vous savez, la Suisse, c’est très tranquille, en particulier à Lausanne. De la part des gens qui viennent au stade, je constate surtout des remerciements, notamment pour le travail accompli avec les jeunes parce qu’on est montés avec l’équipe la plus jeune du championnat et on a reçu à deux reprises le trophée M21 de l’équipe qui fait jouer le plus de U21.
Dans la presse, on vous surnomme « le nouveau Lucien Favre » . Ça vous fait quoi ? En tenant compte du fait que Lucien Favre est probablement l’un des plus grands entraîneurs suisses de l’histoire, ça ne peut être que flatteur. Mais je crois qu’on est tous différents et on me surnomme surtout comme ça parce qu’on partage le sens du sérieux, de la méticulosité, on veut jouer au ballon et depuis l’arrière… On joue comme ça, peu importe de savoir si on gagne ou si on perd. On peut changer plein de choses – les systèmes, l’animation de jeu, les joueurs, les systèmes d’entraînement –, mais la philosophie de jeu reste. Après, je ne l’ai jamais eu comme coach, donc je ne peux pas trop parler.
C’est la raison pour laquelle vous jouez en 3-5-2…(Il coupe.) Non, entre ce qui s’écrit dans les journaux et ce qui se passe sur un terrain, ça n’est pas toujours la même chose, d’autant plus que ça change entre les phases défensives et offensives. On a essayé de jouer en 3-4-3 avec un milieu de terrain en losange, puis un 3-4-3 en ligne avant de revenir vers le 3-4-3 en losange. Les systèmes, je les ai presque tous testés depuis que je suis à Lausanne. Je m’adapte complètement à mes joueurs et à la situation. C’est juste des numéros qu’on doit donner.
Cette volonté de jouer au ballon, de repasser par l’arrière, ça vient d’où ?Si vous vous rappelez l’ESTAC d’Alain Perrin, on voulait absolument la maîtrise du jeu. Pour moi, Alain était un précurseur parce que les schémas tactiques changeaient en fonction de si on attaquait ou on défendait. Je jouais en double 6 avec Jérôme Rothen et, en phase offensive, il s’écartait totalement pour me laisser la parcelle de terrain, tandis que Rafik Saifi rentrait depuis la gauche. Après, on était l’ESTAC et évidemment que ça n’était pas toujours possible. Alain devenait fou quand il voyait que son équipe n’avait pas la maîtrise du jeu.
C’est-à-dire ?C’est-à-dire qu’il pouvait être virulent dans sa manière de gérer le groupe. Je me rappelle un match à Bordeaux où on gagne 2-1. L’ESTAC qui va battre Bordeaux chez eux, bon, on était content. Mais en matière de jeu, on n’avait pas fait un super match, on avait défendu, on s’était battus. On avait gagné, mais sans gros contenu. On s’embrassait dans les vestiaires et Alain est rentré, tout rouge, et nous a dit : « Vous faites quoi là ? Vous avez cinq minutes pour vous doucher et on s’en va ! Vous avez joué à 2km/h, c’était n’importe quoi ! » En tant que joueur, tu ne comprends pas. Bon, maintenant, je comprends un peu plus… Même si je ne partage pas toujours la manière ! (Rires.)
Et ça vous arrive d’être frustré sur votre banc parce que la manière n’y est pas ?Bien sûr ! Je dis souvent à mes joueurs : « Si je m’amuse sur mon banc, c’est qu’on est en train de faire un bon match. » Mais il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte que je ne peux pas me fixer sur le résultat uniquement. En tant que coach, ce n’est pas possible. Un match, ça se joue à rien – un contrôle loupé, un corner, une super frappe d’un joueur adverse –, donc il faut aller chercher le contenu et ne pas se fier à une victoire. On doit sans cesse aller chercher le pourquoi. Quand on a perdu 7-2 face à Young Boys Berne (le 20 août 2016, ndlr), j’ai dit en conférence de presse : « C’est le plus beau match que j’ai perdu. » On avait commis d’énormes erreurs individuelles parce que des joueurs venaient juste d’arriver au club, mais, au-delà de ça, on avait fait un match incroyable. Quand on joue par derrière et qu’on ne gagne pas les matchs, les gens aimeraient qu’on balance devant et, quand on balance et qu’on perd les matchs, les gens se disent : « Pourquoi ils ne jouent pas au ballon ? » Il faut être convaincu, même dans les moments difficiles, comme on en a eu à Lausanne. Je reste persuadé que si le club a des résultats aujourd’hui, c’est parce qu’on n’a pas changé notre idée de jeu depuis trois ans.
Après la Ligue 1, vous avez évolué en Liga à Levante puis à Getafe. En quoi ça vous a modelé en tant que coach ?J’ai joué six ans en Espagne, où j’ai eu Schuster, Laudrup et Míchel en coachs. Donc là, au-delà de l’idée de jeu, ils m’ont appris à le faire partout. Autrement dit, aller à Bernabéu ou au Camp Nou avec le même football qu’ailleurs, se dire qu’on a la possibilité de gagner sur n’importe quel terrain, face à n’importe quelle équipe. J’ai passé dix ans de ma vie à tenter de ressortir les ballons propres. Naturellement, c’est devenu une conviction quand je suis devenu entraîneur.
Schuster, Laudrup et Míchel ont un point commun, en plus d’avoir tous été coachs de Levante : ce sont d’anciens grands joueurs. C’est comment de côtoyer des héros pareils ?Bernd, malgré l’image qu’il a, c’est un mec ultra-positif. Il ne gueule jamais, il voit toujours le verre à moitié plein. Grâce à son expérience dans les trois grands clubs d’Espagne, il sait toute la pression qu’il y a à l’extérieur, donc il a toujours fait en sorte de ne pas laisser pénétrer ça. Il avait des règles, des principes, mais il nous laissait vivre notre métier de footballeur. Il était beaucoup plus ouvert que les coachs que j’avais pu avoir en France, par exemple. Je trouvais ça génial de pouvoir partager des choses avec lui parce que finalement, on est ensemble dans ce truc et pas les uns contre les autres. Michael, il veut jouer au ballon tout le temps, tout le temps, tout le temps. En quart de finale de Coupe d’Europe face au Bayern, le mec nous disait des trucs, on pensait qu’il était fou… Si on l’écoutait, on allait à Munich pour leur foutre le tournis ! Remarque, quand Bernd nous a dit qu’on pouvait remonter un 5-2 en Coupe du Roi, au début on a rigolé et, finalement, après trois semaines de préparation, on était convaincus qu’on pouvait les battre 3-0. Et on a gagné 4-0. J’ai plein d’épisodes dans ma carrière où j’ai été le petit, mais victorieux.
Et durant les entraînements, les toros, ça tâtait encore un peu du ballon ? Míchel ne pouvait plus rien faire à cause de son genou. Bernd aussi, mais à Levante, quand il manquait un joueur, il prenait la place et, même arrêté, il était plus fort que nous. Laudrup, lui, il se mettait tout le temps en situation et il était largement au-dessus de nous. On lui passait le ballon et on observait. Bon, des fois, c’était un peu trop parce que lors des exercices tactiques pour le match du dimanche, c’est lui qui mettait les ballons. On lui disait : « Coach, le problème, c’est que ça va être à nous de les mettre dimanche. Si tu nous en laissais un ou deux, ça serait bien… » (Rires.)
Ces passages en France et en Espagne, en plus du fait que vous êtes italien, ça joue sur la « latinité » de votre effectif ?Non, pas vraiment, parce qu’on n’avait pas de directeur sportif et donc de cellule de recrutement avant janvier. Jusqu’ici, on a travaillé avec mes contacts et bon, mes contacts proviennent de là où j’ai joué ou là où j’ai passé mes diplômes : en Italie, tout simplement. C’est plus une nécessité qu’une véritable envie. Mais dans ma manière d’envisager le foot, je dirais que je suis influencé par la Suisse pour le sérieux, mais que je suis latin… Je suis ni français, ni espagnol, ni italien, ni suisse. Je suis un mélange de tout ça.
Pourquoi avoir passé vos diplômes en Espagne puis en Italie ?Le premier diplôme que j’ai passé, c’était pour être directeur sportif et je jouais encore en Espagne, à Getafe. Quand je suis rentré, j’ai quand même passé des diplômes en Suisse qui sont, je crois, excellents parce qu’ils apprennent les fondamentaux de l’entraînement. J’avais vraiment très envie d’aller apprendre la culture tactique italienne, donc j’ai passé mes deux derniers diplômes là-bas. À près de quarante ans, j’y ai appris des choses qu’on ne m’avait jamais apprises : sur l’orientation des pieds, du corps, sur l’organisation défensive. Un monde entier s’est ouvert à moi en Italie. Là-bas, il y a un mot pour chaque situation. Quand vous donnez un nom qui permet de décrire certaines situations, une fois que les joueurs ont compris cette notion, vous gagnez un temps fou. Il y a un souci du détail tactique incroyable en Italie. Ça en devient presque maladif et je pense que, si on reste en Italie, on oublie cette notion de jeu, de liberté. On oublie qu’il y a un ballon.
C’est la raison pour laquelle vous avez choisi d’aller entraîner à Terracina en Serie D ?Je sortais d’une superbe année en tant qu’adjoint de Bernd Schuster à Málaga. On devait aller à Galatasaray, mais ça ne s’est pas fait. Je voulais continuer à entraîner, j’ai eu cette opportunité en Serie D. Je n’étais personne dans le milieu des entraîneurs, donc ça me semblait normal de commencer par le bas. C’est là qu’on apprend, qu’on met les mains dans le cambouis.
J’ai rencontré des difficultés avec mes dirigeants parce qu’ils ne comprenaient pas qu’on sorte le ballon par derrière. Mais, sportivement, c’était super, on était deuxièmes et on n’a pas perdu pendant trois mois. J’y ai aussi appris les difficultés du métier : on n’était pas payés, les joueurs vivaient à douze dans un appartement… J’ai appris à gérer ces situations-là.
Le Lausanne-Sport vient d’être acheté par un grand groupe, Inéos. Quelle est votre ambition, à terme ?On est un des clubs historiques de Suisse et si on regarde les faits, aujourd’hui, force est de constater qu’on ne l’est pas. On bosse, on reconstruit le club et l’ambition d’Inéos, c’est de replacer le club dans les cinq premières places du championnat.
Ce que vous êtes en train de faire puisque vous êtes cinquièmes du championnat… (au moment de l’interview, huitièmes depuis, ndlr)Oui, sportivement, on y est, mais ça va être compliqué de se maintenir à ce niveau. Il faut aussi qu’on devienne le cinquième club de Suisse en matière d’administration, de marketing, de direction sportive. La locomotive, c’est le sportif, mais il faut avoir vraiment un club pérenne. Plutôt que faire ça rapidement, il faudra que ce soit fait intelligemment. L’argent, c’est bien, mais Manchester City, Chelsea et Paris, ils n’ont pas dix ligues des champions. Il y a des équipes meilleures que nous, à gros budgets, qui ont des difficultés : Zurich a coulé il y a deux ans, Sion est dernier cette année. Je crois qu’il faut savoir d’où on vient afin de construire sur trente ans et non sur cinq.
Et donc, dans trente ans, vous serez encore au Lausanne-Sport ?Je ne sais pas. On va d’abord voir sur les trois prochains mois.
Vous aviez été annoncé du côté de Saint-Étienne l’été dernier avant de refuser. Que s’est-il passé ?À vrai dire, j’avais accepté l’offre. J’avais rencontré Monsieur Romeyer, Monsieur Rocheteau, Monsieur Caiazzo. Je crois qu’il y avait une envie de la part de Saint-Étienne de voir d’autres profils parce que je n’avais peut-être pas l’expérience nécessaire pour un club pareil. Après, quand des noms comme Ranieri, Puel sont annoncés, que ça dure une semaine, deux semaines, j’ai senti qu’il n’y avait pas forcément l’unanimité me concernant. Dans ces conditions, c’est compliqué de travailler. Mais si Monsieur Caiazzo m’avait dit oui lors de notre premier rendez-vous à Paris, j’aurais dit oui à Saint-Étienne. Finalement, plutôt qu’avoir dit non à Saint-Étienne, j’ai dit oui à Lausanne.
Entraîner en France, c’est un objectif ?Mon objectif, c’est avant tout d’entraîner dans un des cinq grands championnats et, bien sûr, la France en fait partie. En plus, je parle français, anglais, espagnol et italien, donc ça élargit les possibilités. Je ne sais pas quand ça sera l’heure, mais quand ça sera l’heure, ça sera l’heure.
![]()
Propos recueillis par Matthieu Rostac, à Lausanne