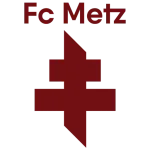- France
- Stade brestois
Olivier Blondel : « À notre époque, certains gardiens faisaient carrière avec des pieds moyens »
Après une pige à Nantes, Olivier Blondel est l'entraîneur des gardiens du Stade brestois depuis cet été. Pendant quasiment toute sa carrière, il aura occupé le rôle de doublure, passant par Le Havre, Toulouse, Troyes, Istres et Strasbourg, et parvenant quand même à disputer une centaine de matchs. Alors, c'est quoi un bon numéro deux ?

Tu commences au Havre en 1997 et tu passes onze ans au club. Raconte-nous ton parcours et comment toi, le Rouennais, tu atterris la bas ?
Il faut savoir qu’au départ, je devais commencer à Rouen, mais le club dépose le bilan à ce moment-là. J’avais plusieurs options sur la table, mais je choisis Le Havre, à 80 kilomètres de chez moi. Et puis surtout, Le Havre me parlait beaucoup parce que c’était un club où les gardiens étaient des figures emblématiques. Il y avait déjà Fabien Piveteau, et au moment où le club me contacte, il y avait Christophe Revault qui entamait sa deuxième saison. La première avait été magistrale et ça m’a convaincu d’y aller, pour apprendre dans un premier temps.
Comment se passent tes débuts ?
Au début, on se rend compte qu’on arrive dans une véritable usine à champions. Que ce soit pour les joueurs ou pour les gardiens, ils ont quasiment tous fini professionnels dans chaque génération : d’un Steve Mandanda international à des joueurs qui ont fait carrière en Ligue 2 ou en National. Chacun a fait sa petite carrière. C’était un club où les gardiens avaient une tradition forte et où la culture de la gagne était transmise, ainsi que la formation. Tout cela me parlait vraiment.
Quand Mandanda arrive, je m’aperçois du phénomène que j’ai en face de moi. Ce n’est pas que je ne suis pas bon, c’est juste qu’il y en a un qui est préparé pour le très haut niveau.
En onze ans au club, tu ne joues que 17 matchs, avec un rôle de doublure. Comment l’as-tu vécu ?
D’un point de vue personnel, ce n’était pas toujours facile. Dans ma génération, il y avait Nicolas Douchez, avec qui je m’entendais très bien. Nous avons fait nos débuts pratiquement en même temps et, à un moment, je voulais être prêté pour avoir du temps de jeu, mais c’est Nico qui est finalement prêté à Châteauroux. Et c’est lui qui lance sa carrière. Moi, le club voulait me garder parce que j’étais une « bonne doublure » : je ne faisais jamais de vagues et je travaillais dur à l’entraînement. C’est un rôle ingrat, mais important, surtout quand on a la bonne mentalité. Et puis, quand Alexander Wencel arrête, Thierry Uvenard veut me lancer, mais à ce moment-là, qui débarque ? Un certain Steve Mandanda. Déjà exceptionnel, qui avait fini meilleur gardien du tournoi de Toulon-Espoir. Là, je m’aperçois du phénomène que j’ai en face de moi. Je commence la saison, mais l’équipe ne tourne pas très bien, alors le coach choisit le phénomène derrière moi. Ce n’est pas que je ne suis pas bon, c’est juste qu’il y en a un qui est préparé pour le très haut niveau, pour l’équipe de France.
Avec un tel espoir dans vos rangs, la cohabitation se passait bien ?
Oui, je n’ai jamais eu de problème. Avec les autres, je n’ai jamais mis de bâtons dans les roues. Je suis quelqu’un de loyal. Ce sont des choix de coach qu’on ne maîtrise pas. Il faut savoir reconnaître quand quelqu’un est meilleur que toi, comme Steve. Une fois qu’il est parti, Christophe Revault est revenu. J’étais sa doublure et je me souviendrai toujours de ce qu’il m’a dit un jour : « C’est exceptionnel d’avoir quelqu’un comme toi comme doublure, tu nous pousses à être meilleurs et tu accompagnes le groupe comme il faut. » C’est ce que je dis souvent aux jeunes gardiens : on n’est pas tous prêts au même âge. Steve, lui, était prêt très tôt ; moi, il a fallu que je quitte Le Havre pour grandir et voler de mes propres ailes, à Toulouse et à Troyes.

À Toulouse, tu arrives du Havre en tant que doublure de Steve Mandanda et tu te retrouves cette fois en doublure de… Cédric Carrasso. C’était un choix ?
En fait, j’avais rompu mon contrat au Havre pour signer à Sannois Saint-Gratien, en National, parce que je voulais jouer. Mais le contrat ne passe pas à la DNCG et le club ne démarre même pas la saison. Je me retrouve donc au chômage. Toulouse cherchait un troisième gardien pas cher, Casanova m’appelle, mais je lui dis que j’irai à l’UNFP et que je préfère attendre, car je voulais jouer. Trois semaines plus tard, toujours rien ; Casanova me rappelle et là je décide de venir, même pour un contrat minimal. C’était mon premier grand départ. Arrivé à Toulouse, je me dis que je ne resterai qu’un an. Mais dès le premier jour, tout se passe très bien. Je tombe dans un super groupe : Gignac, Bergougnoux, Jérémy Mathieu, Daniel Congré… La grande époque de Toulouse. Cette année-là, on finit quatrième et on va jouer l’Europe, c’était un truc de fou.
Tu fais ta première apparition en Ligue 1 la même année. Tu sentais que ça allait arriver ?
À un moment, le coach voit mes qualités et un jour il me prend à part et me dit : « Tu sais, si j’ai un problème un jour avec Carrasso, c’est toi que j’alignerai. » Je joue en réserve pour avoir du temps de jeu, et un samedi après-midi, je reçois plein d’appels. On me dit de faire mes valises et de rejoindre l’équipe à l’aéroport. Carrasso est absent. Là, je me dis : « On va voir si le coach a tenu parole ou pas. » Il me titularise dans le 11 du lendemain. Le plus drôle, c’est que le matin même du match je bois un café, et Dédé Gignac vient me voir et me lance : « C’est aujourd’hui qu’il faut être bon. » Tout s’est bien passé, et je gagne ma place de deuxième gardien. J’ai attendu 28-29 ans pour jouer mon premier match en Ligue 1.
Est-ce que tu sens que ta carrière arrive à un tournant à ce moment-là ?
À Toulouse, je n’avais rien à perdre, j’ai pris énormément de plaisir au quotidien. Le groupe, l’ambiance, tout cela joue sur le psychologique. Je sentais que je jouais hyper bien. Malheureusement, l’année suivante, je me fracture le péroné alors que ma carrière semblait lancée. Ce sont des signes qu’on n’a pas toujours une carrière facile, mais tout ce que j’ai vécu est enrichissant. Je faisais de gros matchs et là, la blessure te stoppe net.
Je suis resté très attaché à Toulouse. C’est là que j’ai rencontré ma femme, que j’ai vécu de grands moments : la Ligue 1, la Coupe d’Europe… Des choses inespérées quand je repense à mon parcours commencé au Havre.
Tu décides donc d’aller à l’ESTAC en 2010, qui vient tout juste de remonter après une pige en National, c’était pour te relancer ?
Oui, et je ne regrette absolument pas. Après ma blessure, je voulais jouer, c’était vraiment le plus important pour moi. Trois clubs de Ligue 2 s’intéressaient à moi, mais le discours de Frédéric Adam (le directeur sportif de Troyes, NDLR) me plaisait. Même avec un changement de coach avant la reprise de saison, Jean-Marc Furlan était content de m’avoir. Le club était très familial, avec peu de moyens, mais j’ai beaucoup apprécié la famille Masoni. Le coach Furlan nous faisait bien jouer au football. On accroche le maintien la première année, et la deuxième, on monte. C’était vraiment deux belles années.
À l’ESTAC, tu es sûrement au sommet de ta carrière, mais tu ne restes pas au club alors qu’il monte en Ligue 1. Pourquoi ?
Je fais les six premiers mois, on est premiers. Puis on joue le derby à domicile contre Reims et je me fais une rupture complète du tendon de l’adducteur. Cela a été très compliqué, j’ai mis plus de quatre mois et demi à revenir. Entre-temps, Yohann (Thuram-Ulien) faisait de bons matchs. En fin de saison, le coach me dit : « Je veux te garder », mais il précise que ce sera Yohann qui démarrera la saison. J’avais alors 31 ans, et lui représentait une valeur marchande plus intéressante pour le club. Il était en pleine bourre, il faut le reconnaître. Donc je retourne à Toulouse.
Tu reviens là où tout avait marché pour toi lors de ton premier passage. Tu sentais qu’il fallait y retourner ?
Déjà, il faut savoir que j’ai été le seul joueur de l’ère Sadran à revenir au club, ce qui prouve que j’avais laissé une bonne image. Je me retrouve alors derrière Ali Ahamada. Mais ça ne se passe pas très bien, car il fait beaucoup d’erreurs. Chaque semaine, je vois que le coach ne me met pas, et je commence à ruminer. Je me dis que je n’aurai jamais ma chance. Quand je l’ai enfin, ça ne se passe pas très bien non plus. C’était compliqué. S’il y a une expérience à retenir, c’est que ce n’est pas parce qu’on a laissé une bonne impression lors d’un premier passage que le deuxième se passera aussi bien. Malgré tout, je suis resté très attaché à Toulouse. C’est là que j’ai rencontré ma femme, que j’ai vécu de grands moments : la Ligue 1, la Coupe d’Europe… Des choses inespérées quand je repense à mon parcours commencé au Havre.

Tu pars ensuite à Istres en 2014 avant de finir à Strasbourg en 2016. Après Toulouse, tu avais encore envie de jouer ?
Le coach Casanova m’avait dit : « Ne pars pas, tu peux avoir un emploi à vie au club. » Mais moi, je voulais encore jouer. À Istres, je suis titulaire, mais le club traversait une période interne très compliquée. Ce n’était pas évident à vivre, mais ce sont des expériences qui servent pour la suite. Je ne voulais pas finir sur ça, et Strasbourg m’appelle. Là-bas, ma mission est d’apporter de l’expérience et de canaliser le groupe. Je forme un binôme avec Alexandre Oukidja, et cette année-là, on monte en Ligue 1. Malheureusement, en mars, je me fais les croisés. J’avais 37 ans, et je me suis dit : « C’est bon, il est temps de passer à ce que tu voulais faire depuis toujours : entraîner. »
Avec Troyes, on se sauve à l’avant-dernière journée contre Laval, dans un match mal embarqué. À la fin de la soirée, je me retrouve dans une fontaine à danser avec le président Masoni.
Après 20 ans de carrière en Ligue 1 et Ligue 2, quels souvenirs gardes-tu en particulier ?
En regardant ma carrière, j’ai disputé plus de 100 matchs (101 exactement, NDLR). Mes souvenirs ? Ce n’est pas un moment isolé, mais plutôt un constat : je n’étais pas talentueux, j’étais besogneux. Je mettais une énorme énergie à l’entraînement pour exploiter au maximum mon potentiel. Mon premier match à Sochaux reste un des grands souvenirs, parce que je l’ai joué avec le cœur. En fait, tout ce que j’ai vécu, je l’ai vécu avec passion. Je n’ai jamais cherché les paillettes ni le côté médiatique. Jouer en Ligue 1, goûter à l’Europe, comme ce match à Trabzonspor où, en allant dans mon but, j’ai vu la haine dans les yeux des supporters adverses… Ce sont des matchs dont j’ai rêvé et à chaque fois je me disais : « Vas-y, croque dedans ! » Pareil avec la fête du maintien à Troyes : on ne se rend pas toujours compte de ce que c’est de jouer le maintien dans certains clubs, mais parfois, un maintien procure plus d’émotions qu’une montée. On se sauve à l’avant-dernière journée contre Laval, dans un match mal embarqué. À la fin de la soirée, je me retrouve dans une fontaine à danser avec le président Masoni. Ce sont des émotions, tout simplement. J’ai joué au foot pour ça.
Pour ce nouveau chapitre, cette fois-ci en tant qu’entraîneur des gardiens, tu commences à Amiens et ensuite Lyon vient te chercher. Quelles étaient tes attentes dans ce nouveau rôle ?
Lyon vient me chercher pour encadrer les gardiens de la réserve et mettre en place un plan de développement du centre de formation jusqu’aux pros. Mon rôle était double : travailler au quotidien avec les jeunes de la réserve et poser une philosophie commune pour toute l’école des gardiens. À Lyon, le contexte est particulier. Je n’ai pas connu le « grand Lyon » de Gerland, mais j’ai trouvé une véritable usine à champions. En tant qu’entraîneur de gardiens, j’étais un peu en marge des tensions internes. On nous a demandé de poser un projet, et j’ai essayé de donner une ligne directrice claire. Je me suis retrouvé avec des jeunes à très gros potentiel comme Patouillet ou Bengui. Certains sont devenus internationaux jeunes, d’autres ont signé pro. Mon rôle, c’était de les accompagner pour exploiter leur potentiel au plus vite, même si à Lyon, le poste de numéro un est tellement exigeant qu’ils doivent souvent aller chercher de l’expérience ailleurs avant d’avoir leur chance.
Tu fais une pige à Nantes avant d’atterrir à Brest cette année. Comment ça s’est fait ?
Antoine Kombouaré voulait renouveler son staff et je signe pour six mois. J’arrive dans un club avec une grande ferveur populaire. Le projet me séduit, même si je sens que ça sera compliqué pour Kombouaré. Comme je suis quelqu’un de valeur, j’aurais eu du mal à continuer avec Nantes. Puis Brest me contacte (suite au départ de Christophe Revel, NDLR). Ils avaient suivi mon travail et cherchaient à renouveler leur staff. C’est un club qui correspond à mes valeurs : familial, avec une vraie identité. Le discours m’a beaucoup plu et comme je suis un homme de projet, j’ai dit oui.

Brest vient tout juste de se séparer de Marco Bizot, qui était vraiment le porte-étendard de l’équipe. Comment ça se passe au niveau des gardiens en ce moment ?
Moi, je suis arrivé, j’ai passé dix jours avec lui, et on sent que c’était quelqu’un qui a marqué le club. C’était vraiment le « rock brestois ». Brest a vécu une épopée en deux ans exceptionnelle et aujourd’hui, c’est un nouveau cycle, mais il faut essayer de faire aussi bien que ce que Marco a fait. Ça sera peut-être difficile, mais au moins essayer de créer quelque chose au niveau des gardiens de but, où il doit y avoir une continuité. On réfléchit aussi à quelles seront les meilleures options, qu’est-ce qu’on peut mettre en place pour que même les jeunes à Brest, au niveau des gardiens, s’épanouissent encore plus et puissent rejoindre le groupe pro.
Ce que les coachs ne comprennent pas toujours, c’est qu’un gardien peut être excellent avec ses pieds mais, s’il ne fait pas d’arrêts, il ne fera pas gagner de points.
Le poste de gardien de but a énormément évolué depuis la fin de ta carrière. Quelles ont été les plus grandes évolutions depuis une dizaine d’années ?
Je dirais qu’avant, il y avait dix joueurs et un gardien, et qu’aujourd’hui, l’équipe, c’est vraiment onze. La manière de se connecter au jeu a complètement changé. Aujourd’hui, le gardien doit être complet. À notre époque, certains faisaient carrière avec des pieds moyens, d’autres n’étaient pas très à l’aise dans les airs. On pouvait réussir même avec un petit manque dans un domaine. Aujourd’hui, les gardiens doivent savoir tout faire et je pense que le gardien sera encore plus intégré au jeu dans les années à venir. À notre époque, on gérait beaucoup l’espace devant nous grâce à la distance avec notre bloc. Mais à l’avenir, il faudra gérer des espaces en reculant rapidement et être très à l’aise dans les espaces latéraux.
C’est une bonne ou une mauvaise chose ?
C’est une bonne chose, mais si le gardien ne réalise que 7% d’arrêts dans un match, ça pose problème. Ce que les coachs ne comprennent pas toujours, c’est qu’un gardien peut être excellent avec ses pieds mais, s’il ne fait pas d’arrêts, il ne fera pas gagner de points. Ce petit pourcentage d’actions décisives reste déterminant et n’est pas assez valorisé, car on privilégie parfois le jeu au pied pour faire plaisir aux coachs. Aujourd’hui, le gardien doit être décisif, connecté au jeu et polyvalent. Mais ce critère-là — l’arrêt décisif — restera celui qui marque le plus les esprits. Il ne faut pas oublier que les coachs veulent avant tout un gardien capable de faire gagner des matchs.
Deux défaites d'affilée pour TroyesPropos recueillis par Titouan Aniesa