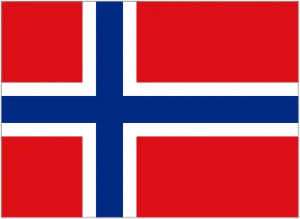- Culture foot
- Interview
Philippe Delerm : « Iniesta, c’est un Dhorasoo qui a réussi »

Sous sa grande coiffe blanche qui lui confère de furieux airs de Michaël Haneke, Philippe Delerm n’a pas assez d’une heure pour conter ses souvenirs foot. Toujours prompt à glisser dans ses ouvrages quelques lignes sur la beauté d’un hymne gallois ou l’élégance d’une passe aveugle, le chantre des plaisirs minuscules avoue en plus ne pas supporter nager là où il n’a pas pied. Voilà peut-être pourquoi, après avoir attendu des années le succès de sa Première Gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, il voue désormais un amour véritable aux perdants du football.
Quand vous étiez petit, vous jouiez « aux boutons avec des buts en pâtes à modeler » . Comment ça marchait ? J’étais fils d’instituteur à Sèvres, à l’époque on habitait dans l’école dans un logement de fonction. Le concierge avait un fils passionné de foot qui avait deux-trois ans de plus que moi. Il avait inventé un jeu : les joueurs étaient d’assez gros boutons, le ballon était un petit bouton de chemise blanc. On pouvait faire des passes, des tirs, la prendre un peu de l’extérieur pour brosser le bouton. Moi, je n’avais que deux équipes et des cages en pâtes à modeler, lui avait même peint des bandes aux couleurs des équipes sur les boutons. Et ça pouvait durer… des heures ! La plupart du temps, on raclait nos chaussures sur le sol pour avoir des petits bouts de gomme qui faisaient la balle (rires).
Vous dites : « On croit toujours au foot quand on a joué au boutons. » Il y a des choses qui vous font douter du foot ? Il y a de plus en plus de choses qui font douter du foot. Parfois, on se dit qu’on est un peu vicieux de continuer à rester aussi accro à un sport où il y a tant de pauvres mecs… Les premières images qui m’ont donné une idée de ce qu’était la mythologie du football, ce sont des cartes qu’on gagnait avec des chewing-gums. Il y avait des photos du stade de Reims, du Real Madrid avec Kopa, Di Stéfano… Comme j’étais lecteur, j’ai rapidement dégoté des livres sur le sujet, dont un qui s’appelait Kopa, Coppi et autres champions Il racontait la façon dont Kopa est descendu à la mine, comment il s’est cassé le doigt en recevant un éboulis, accident à la suite de quoi il est sorti de la mine. C’est un livre qui me tient beaucoup à cœur.
L’Équipe avait titré « Fabuleux » au lendemain du désastre de Séville 1982, un épisode qui vous a évidemment marqué. Dans La tranchée d’Aremberg et autres voluptés sportives, vous dites : « Ils auraient pu titrerSi près du paradis. Mais peut-être que c’est bien ennuyeux, le paradis. » Vous avez toujours eu une affection particulière pour les perdants… D’abord, c’est vrai. Il y a plein de gens que je n’ai pas envie de retrouver au paradis. Mais surtout le paradis oui, ce doit être ennuyeux. Il n’y a plus rien à espérer, quoi. Une fois qu’on a été champions du monde, bon ben… D’abord, j’ai vécu le foot dans une culture de la défaite. Dans les années 1960, on était toujours battus, que ce soit en sélection ou en club. La première chose qui change vraiment, c’est Sainté 1976, où il se passe vraiment quelque chose avec le retour contre Kiev (victoire 3-0 en quart de finale de C1, ndlr). Là, c’est vraiment le début d’autre chose, qui se termine en gros avec la fin du carré magique en 1986. Puis après, on passe dans une période que j’ai à nouveau moins aimé, parce que c’était les années Tapie, et de manière générale en France des années bling-bling… On respectait le vainqueur, le meilleur, le premier…
Et vous vous êtes construit en opposition à tout cela ?Oui, puis quand j’étais adolescent, de toute manière, on perdait, alors il fallait trouver la défaite normale et la victoire miraculeuse. Ça ne me dérangeait pas, ça sacralisait le foot. Finalement, ça rend les choses encore plus magiques. La fille que vous n’arrivez pas à séduire, elle a toujours quelque chose de plus mystérieux que celle qui vous aime – ce n’est pas moi qui ai commencé à le dire, c’est Marcel Proust.
Est-ce parce que vous retrouvez en ces galériens une parabole de votre propre parcours, vous qui avez mis plus de dix ans avant de voir vos ouvrages acceptés par un éditeur ?Ah ben c’est vrai, vous êtes la première personne qui me le dit… c’est sûrement pas faux. Je me rends compte que j’ai très longtemps écrit dans la solitude : dix ans sans arriver à publier un bouquin, puis quinze ans à vivre un peu à l’arrache avec un éditeur très sympa (les Éditions du Rocher, ndlr), qui me disait : « Vous n’avez pas fait un choix facile, mais un jour vous aurez du succès… » J’aime beaucoup la mélancolie et l’attente des choses. Je sentais que j’étais fait pour avoir de la chance, mais simplement qu’elle ne me venait pas. Ce qui peut rendre encore plus mélancolique d’ailleurs, c’est fort comme sentiment. Il y a pas mal de gens qui ont caressé ce type d’écriture, mais c’est sur moi que c’est tombé, voilà. J’ai eu beaucoup de chance et j’ai infiniment plus apprécié mon succès du fait de l’avoir attendu.
Vous avez écrit dans Tranchée d’Aremberg une ode au You’ll Never Walk Alone. Et en parlant des supporters de Liverpool quand Gerrard a failli quitter le club, vous dites : « Quand ça va mal, on chanteYou’ll Never Walk Alone. » Vous quand ça va mal, vous chantez quoi ? Oh quand ça va mal, je n’ai que l’embarras du choix… les plus grandes chansons sont tristes. Je chante Mon enfance de Barbara, Chatenay-Malabris de Vincent Delerm qui est une grande chanson de tristesse… D’ailleurs, après mon premier succès, j’ai été invité partout et tout le monde me disait « oh ça doit être formidable » , mais j’ai trouvé ça beaucoup plus grand de vivre des mélancolies avant. Les gens ne me croyaient pas : il y a une espèce de perfection dans la façon d’attendre.
Vous dites qu’aujourd’hui dans le sport, les sportifs n’ont plus le droit à la tristesse.Je pense que le clivage maximal a été 1982 et France-RFA. On était tous tellement tristes, mais en même temps ce malheur-là était magnifique, il y avait tellement de choses belles et fortes derrière… Puis Platini avait un tel coefficient de sympathie… Moi, je trouve qu’ils avaient un style de gauche en plus. Rocheteau, Platini… le maillot par-dessus le short, tiens. C’était un signe pour moi, un peu beatnik.
Le maillot par-dessus le short, c’est un truc de gauche ?Ben, si vous voulez, le maillot impeccablement rangé dans le short, c’était un truc un peu rectiligne, un peu de droite, quoi. Puis Platini qui n’avait pas vraiment l’air d’un sportif – malgré des qualités physiques évidentes, mais qui ne jure pas que par les abdos… Quand il va tirer son coup franc avec son maillot descendu au-dessous du short, il a pas l’air du mec qui va le mettre au fond, quoi. C’était une inélégance qui touchait à l’élégance. Un truc propre à ces années-là parce que Rocheteau avait aussi ses longs cheveux bouclés… Il avait une esthétique de gauche, Rocheteau.
Cette appétence pour les perdants magnifiques, elle se retrouve dans les équipes qui vous font vibrer ?Oui, et dans les joueurs aussi. J’ai eu beaucoup de plaisir à écrire un texte sur Vikash Dhorasoo, qui est pour moi emblématique du type de joueurs que j’aime. En partie parce qu’il n’a pas réalisé la carrière qu’il aurait dû faire.
Justement c’est un vrai mystère, vous devez être peu à dire « mon joueur préféré c’est Dhorasoo » … Déjà, j’adorais le genre du numéro 10 qu’il était. Plus tard, je l’ai rencontré personnellement et j’ai découvert qu’il était assez intello, il m’a dit « mais j’avais un football de lâche » . Il faisait la passe au lieu de prendre sa chance lui-même, quoi. C’est beau comme manière de parler. Puis je ne pense pas que ce soit vrai, je trouvais son style délicieux. En plus, il avait une belle tête, un beau visage. Et puis cette façon d’être très personnel, un peu réticent, un peu loin comme ça… j’aime beaucoup ce type d’éloignement. Ça changeait un peu des gros beaufs qu’on voyait à l’époque sur le terrain.
Quel est le joueur pour lequel vous avez l’impression que c’est toujours la première gorgée ?Je ne vais pas vous étonner, j’ai un joueur fétiche qui commence à vieillir : c’est Iniesta. C’est un Dhorasso qui aurait réussi, quoi. Puis ça m’a fait plaisir qu’il marque ce but en finale de la Coupe du monde 2010, il n’est pas du tout conçu pour ça a priori : être le buteur victorieux en finale de Coupe du monde. C’était symbolique que ce soit lui. En général, les gens qui vous disent qu’Iniesta est leur joueur préféré, ça leur paraît comme une évidence. C’est une famille d’esprit. Quand on sait soupeser ce que c’est qu’une passe au football, il a quand même quelque chose de spécial…
Vous avez dans vos livres une réelle délectation du geste parfait : le passing-shot de Rafaël Nadal, la course d’élan de Carl Lewis, le lancer de javelot de Jan Železný. Quel est celui qui, effectué parfaitement au foot, retient votre admiration ?Les plongeons de gardien de l’époque où je me suis mis à aimer le foot. C’étaient des gardiens dont on disait qu’ils en faisaient parfois un peu trop, pour le spectacle. Il y avait le gardien du Racing, Daniel Varini, un spécialiste. Il faisait trois tours sur lui-même quel que soit le tir… Mais en même temps, il y avait une extension qui était quelquefois fabuleuse. Il y a la reprise de volée aussi. La plus extraordinaire que j’ai vue, c’est une de Jean-Michel Larqué en finale de Coupe de France contre Lens : le centre vient carrément du poteau de corner et il la reprend aux 18m, mais… incroyable, en pleine lucarne. En même temps, tout ça, ce sont des gestes spectaculaires, et je crois encore plus préférer avoir vu à quel point une passe d’Iniesta ou Pastore était subtile. Et puis éventuellement, avec beaucoup de cuistrerie, faire partie des initiés qui peuvent dire : « Hey, t’as vu un peu la passe ? » en espérant que la personne à côté de moi ne l’a pas vue.
Quelle est votre odeur préférée du football ?L’odeur d’une crème chauffante qu’on se mettait sur les cuisses avant les matchs, le Dolpic. Quand on rentrait dans les vestiaires ça empestait, en même temps c’était un truc un peu impressionnant. Ça prouvait qu’on était dans la compétition.
Votre son préféré du foot ?(Il réfléchit longuement) C’est un son qui n’a rien d’original, mais qui est lié au moment où je l’ai vécu. Il correspond aux premières fois où j’ai pu aller au Parc des Princes tout seul quand j’avais 14-15 ans. C’était dans l’ancien Parc des Princes, il y avait deux équipes qui jouaient à l’époque : le Racing et le Stade français. Quand on rentrait, on pouvait voir le terrain à travers les barreaux, je me sentais un peu perdu. Ce bruit, il est lié à une rumeur qui se répercutait grâce aux tribunes très hautes, comme ça, une rumeur qui habitait tout d’un coup ce quartier par ailleurs un peu chicos. Je l’entends encore quand j’en parle, tiens. Ça me faisait peur en même temps, il y avait une sorte d’appréhension. On se rendait compte tout d’un coup qu’on n’était pas le seul à avoir cette passion. Le centre du monde était là.
Propos recueillis par Theo Denmat